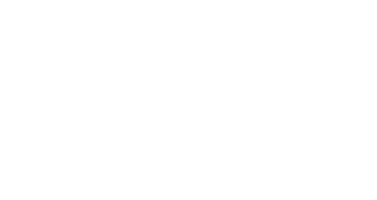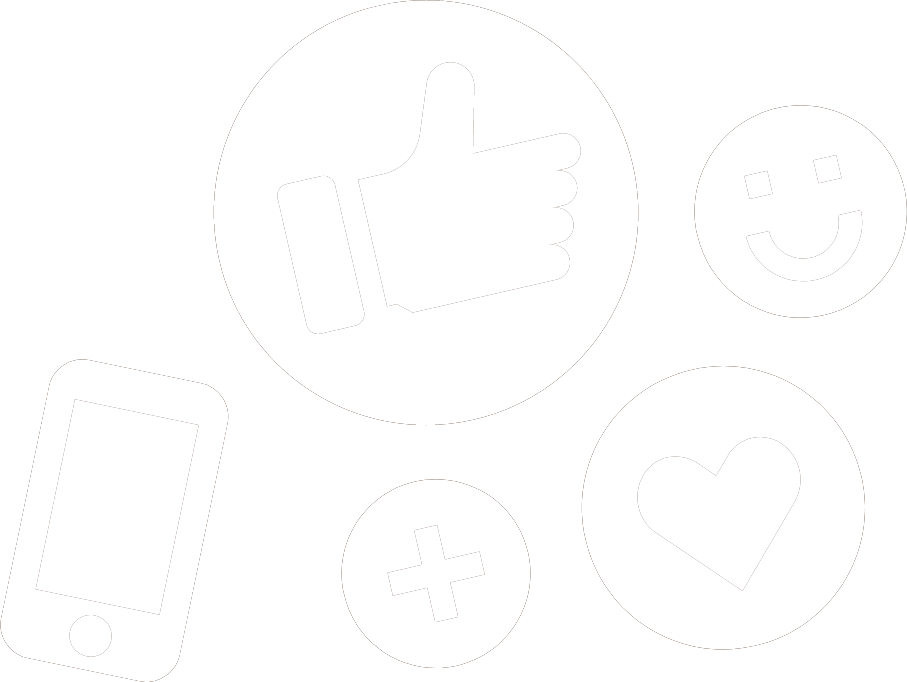Changer de République, une urgence pour la gauche
17 avril 2013 Par Les invités de Mediapart
Pour un nécessaire changement de politique et face à une majorité de gauche « déjà moribonde », l’historien Roger Martelli juge qu’il ne faut pas attendre « sa décomposition » mais plutôt manifester le 5 mai pour une VIe République qui serait « moins soucieuse de bonne représentation que de pleine implication citoyenne ». Manifester « pour que la gauche de la justice et de la citoyenneté redevienne majoritaire ».
Jérôme Gleizes vient de publier un billet sur son blog dans Mediapart. Je partage son inquiétude sur la dimension délétère de la situation politique actuelle. La politique gouvernementale conduit la gauche dans le mur et ouvre un boulevard à une droite de plus en plus radicalisée, avec un FN en embuscade, qui attend son heure. Je conviens avec lui que l’heure est au rassemblement, davantage qu’à la stigmatisation. Demander que les têtes tombent ne fait qu’ajouter de la violence à la violence, du ressentiment au ressentiment.
Je pense, moi aussi, qu’il ne faut pas que la colère vire au ressentiment. La colère peut nourrir la combativité ; elle est alors le prélude à l’action, le ferment possible d’un changement. Le ressentiment, lui, ne porte pas à lutter contre les causes du mal, mais à chercher les boucs émissaires. La colère peut aller jusqu’à la révolution ; le ressentiment mène au fascisme. Mais le ressentiment ne gagne que lorsque la colère se marie avec la désespérance. C’est à partir de là que je diverge du propos de Jérôme Gleizes.
Il ne faut pas se contenter de changer les hommes, mais d’abord de politique : d’accord. Mais comment obtenir un changement de politique ? Il n’y a, à gauche tout au moins, que deux méthodes possibles. La première consiste à accompagner de façon critique la politique suivie par le sommet socialiste de l’État. C’est le choix de la gauche socialiste et, pour l’instant, celui d’EE-LV. Ce fut, entre 1997 et 2002, la méthode retenue par le PCF de Robert Hue. On en a mesuré hier l’inefficacité. Comment pourrait-il en être autrement aujourd’hui ? Si la logique prônée par Hollande et Ayrault était une parenthèse, une inflexion tactique, quelque chose comme une « pause », on pourrait à la rigueur penser qu’il suffit, tous ensemble, de pousser assez fort pour obtenir une réorientation en interne.
Le problème est que la politique de l’État n’est pas un simple accident de parcours. Le Parti socialiste avait le choix, avant 2012, entre la gauche et le centre. Il a choisi le centre. Son modèle « vrai » est celui du blairisme. Le capitalisme financier étant incontournable, il faut agir à l’intérieur de ses mécanismes, pour assainir la situation économique (réduire la dette publique) et éviter l’explosion sociale. Pour éviter l’explosion, il faut de la redistribution à la marge, de la mise au travail (les petits boulots, pas les allocations-chômage) et de l’ordre (c’est le paradigme de la sécurité). L’idéal, c’était donc Cahuzac plus Valls ; il nous reste Valls.
Cette cohérence-là ne va pas changer. Non pas parce que le Parti socialiste est intrinsèquement pervers, mais parce que le rapport des forces ne le permet pas. La méthode de l’accompagnement (faire que le gouvernement réussisse) risque ainsi d’être pure incantation. Opposer au social-libéralisme ambiant l’urgence d’un changement de politique suppose qu’existe une stratégie qui permet de modifier ce rapport des forces. Une dimension de la solution échappe pour l’essentiel au monde politique : celle de la combativité sociale. En désignant une perspective possible, l’espace politique peut stimuler cette combativité ; il ne la crée pas pour autant.
En revanche, il est de sa responsabilité de dire quelle dynamique d’agrégation peut substituer un cycle vertueux de mobilisation au cycle infernal de la crise morale. Sur ce point, impossible de tricher. Il ne suffit pas de supplier le gouvernement de faire d’autre choix : il convient de dégager une nouvelle majorité, à gauche, pour mettre en œuvre une autre logique. Toute autre méthode conduit à l’échec. Aux essais d’accompagnement, je préfère donc que la gauche exigeante se retrouve dans la méthode d’une construction alternative. L’alternative ne s’énonce pas : elle se construit. C’est dire qu’elle s’inscrit dans le temps long. Mais ce temps n’est pas celui de la vie éternelle, ou celui de l’au-delà. On ne devient un jour majoritaire que si l’on commence à se rassembler.
À mes yeux, ce commencement suppose que l’on s’astreigne à quelques exigences, qui relèvent à la fois du réalisme et de l’éthique. La première est celle de l’ambition : quand la crise est si profonde, les demi-mesures n’ont plus d’efficacité. La racine des maux dont souffre nos sociétés se trouve dans la conjonction du libéralisme extrême et de la « gouvernance », d’une logique économico-sociale et d’une méthode de régulation. Difficile de différer plus longtemps le moment d’une rupture amorcée. Or la gauche a l’habitude de réclamer « l’autre politique » en matière d’économie ; elle est moins diserte quand il s’agit de parler d’institutions. En général, c’est la droite qui se croit assez légitime pour changer d’institutions et, quand elle s’y adonne, elle ne fait pas dans le détail : l’exemple de 1958 est là pour le montrer !
En général, la gauche est trop timide pour changer la République ; au mieux, elle s’autorise à l’infléchir. À elle, pourtant, de prendre le taureau par les cornes. Le « système » actuel est un melting pot : une louche de norme libérale économique, une grosse cuillère de confusion du public et du privé, une lampée de reflux de la loi, un zeste d’affaiblissement de la représentation, une noix d’expertise, le tout enrobé dans une bonne couche de gouvernance, avec, à la clé, l’alternance au pouvoir d’une droite dure et d’une gauche molle. Voilà la recette qu’il convient désormais d’oublier. Et, pour y parvenir, nous avons besoin d’un bon poêlon de développement des capacités humaines (le « moteur » économique) et d’un chaudron de démocratie rénovée (le « carburant » mental).
Voilà des années que l’on nous explique qu’il n’y a pas de vie démocratique pensable en dehors de la Cinquième république. Il est plus que temps d’affirmer qu’il n’en est rien. Et, pour faire bonne mesure, autant affirmer haut et fort que la République nouvelle indispensable sera à la fois la Sixième d’une longue lignée et la première d’une texture différente, moins soucieuse de bonne « représentation » que de pleine « implication citoyenne ». On n’en est pas à la Constituante ? On en était loin en janvier 1789. Qui ne demande rien n’obtient rien. Différer le débat institutionnel, au pré
texte que la droite menace, c’est laisser le terrain démocratique à ceux qui le parsèment de mines « anti-personnel ».
Notre horizon devrait être celui d’une nouvelle majorité à gauche, tout simplement parce que celle d’hier est déjà moribonde. N’attendons pas sa décomposition : ce serait un trop beau cadeau à la droite de régression absolue. Elle est si sûre d’elle, qu’elle prétend tenir désormais la rue. Jusqu’à ce jour, la gauche ne s’est jamais si bien portée que lorsqu’elle ne l’a pas laissé faire. Le 5 mai est une occasion de relever le défi. C’est le Front de gauche qui appelle au rassemblement ? Peut-être, mais l’événement ne sera pas la propriété du Front de gauche. Le succès de la marche sera celui de toutes celles et ceux qui y participeront. Manifestons donc ensemble et partageons les fruits de notre impulsion commune.
Ne le faisons pas pour « qu’ils s’en aillent tous », mais pour que la politique d’hier et d’aujourd’hui soit balayée. Non pas pour que la droite socialiste perde (ce serait vouloir que gagne la droite du pire), mais pour que la gauche de la justice et de la citoyenneté redevienne majoritaire à gauche. Pour que ce moment advienne, il ne faudra pas demander à tel ou tel s’il a soutenu, à un moment ou à un autre, la politique socialiste pour l’instant majoritaire, s’il a été au gouvernement ou s’il s’y est opposé dès le début. Aucun convive n’est indésirable à la table du changement social. Mais, dans l’immédiat, il est décisif que ceux qui le veulent et qui le peuvent se retrouvent dans la rue. Pour donner sa chance à un avenir humain. Tout simplement humain.
Roger Martelli, historien, codirecteur de Regards