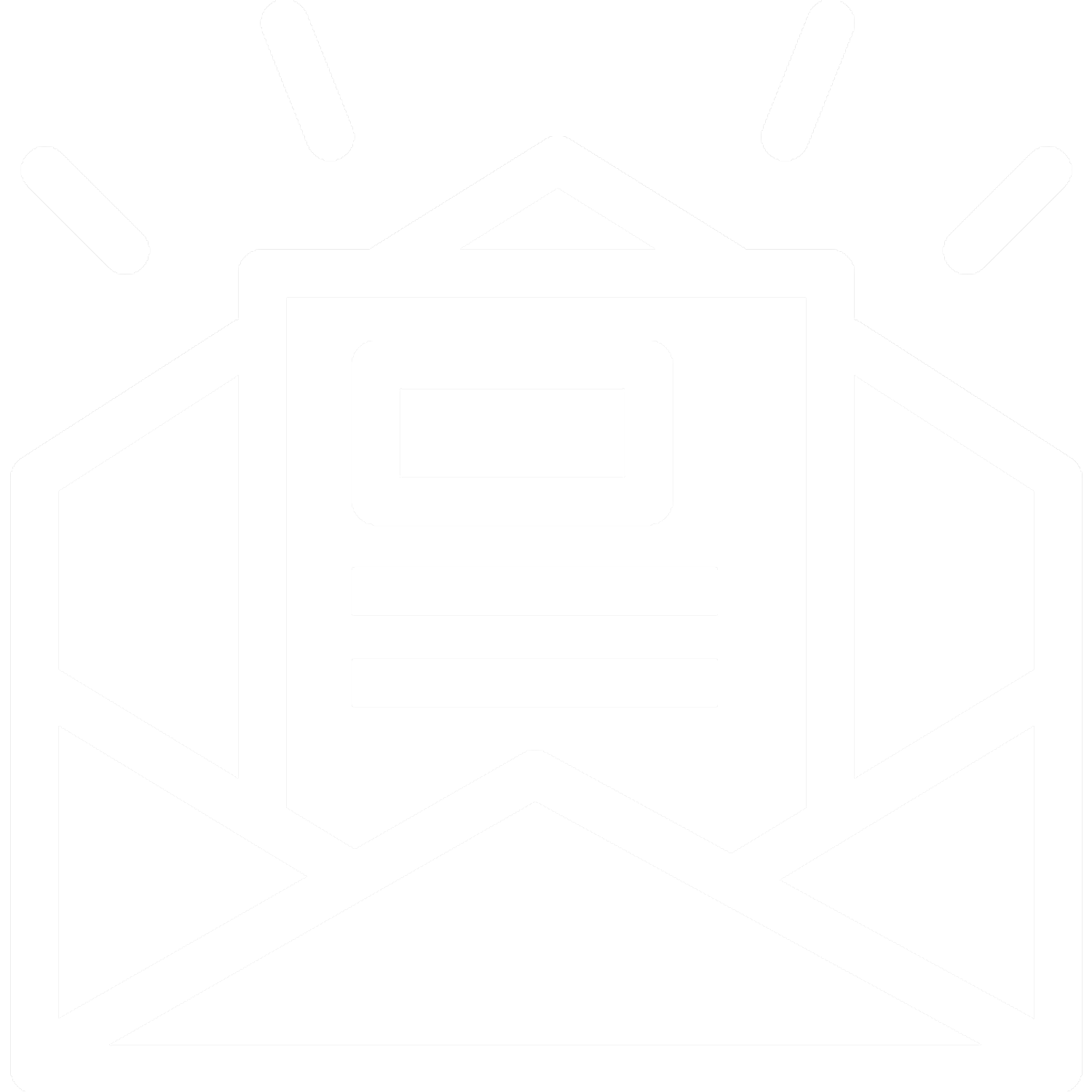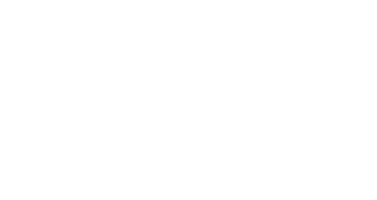| 27.08.11 | 13h38 • Mis à jour le 27.08.11 | 13h38
| 27.08.11 | 13h38 • Mis à jour le 27.08.11 | 13h38
 Le metteur en scène Bernard Sobel ouvre la saison du Théâtre national de la Colline avec, du 9 septembre au 8 octobre, L’Homme inutile ou la Conspiration des sentiments, une pièce de l’écrivain russe Iouri Olecha (1899-1960). Un auteur qu’il a fait découvrir en France avec Le Mendiant ou la Mort de Zand, en 2007. Agé de 76 ans, l’ancien directeur du Théâtre de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), qu’il a fondé puis dirigé de 1963 à 2007, s’impose comme une figure unique, en raison de ses choix artistiques et de son engagement jamais renié au Parti communiste.
Le metteur en scène Bernard Sobel ouvre la saison du Théâtre national de la Colline avec, du 9 septembre au 8 octobre, L’Homme inutile ou la Conspiration des sentiments, une pièce de l’écrivain russe Iouri Olecha (1899-1960). Un auteur qu’il a fait découvrir en France avec Le Mendiant ou la Mort de Zand, en 2007. Agé de 76 ans, l’ancien directeur du Théâtre de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), qu’il a fondé puis dirigé de 1963 à 2007, s’impose comme une figure unique, en raison de ses choix artistiques et de son engagement jamais renié au Parti communiste.
Quel intérêt, l’année du cinquantenaire de l’érection du mur de Berlin, de monter une pièce qui se passe dans l’Union soviétique des années 1920 et montre le tiraillement entre le monde ancien et le nouveau – celui du communisme, qui s’est effondré avec la chute du Mur, en 1989 ?
L’intérêt réside dans le fait que c’est une pièce prophétique. Son auteur, Iouri Olecha, a vu le jour en 1899, à la naissance d’une expérience qu’on appelle le communisme, mais que je préfère appeler le socialisme réel existant. Il a écrit L’Homme inutile ou la Conspiration des sentiments en 1928. Et tout ce qu’il raconte dans la pièce s’est réalisé. Aujourd’hui, on peut se dire : voilà quelqu’un qui a crié dans le désert, et qui a eu le courage de montrer que le système allait droit dans le mur – c’est le cas de le dire.
Pour moi, il ne s’agit en aucune façon, en montant sa pièce, de revisiter l’Union soviétique, ni de poser le problème du communisme. Il s’agit de montrer la fracture d’un monde, parce que nous en vivons une aujourd’hui. Tous les journaux parlent de l’écroulement d’un système. Je pense qu’on vit dans une situation d’angoisse positive, qui est la même que celle dans laquelle se trouvaient les Russes quand ils tentaient une expérience absolument abracadabrante.
Qu’entendez-vous par « angoisse positive » ?
Elle est positive parce qu’elle force chacun à penser. Jusqu’à présent on pouvait jouir, si on veut, sans penser. Plus ou moins. Aujourd’hui, chacun est obligé de penser. Même si c’est pour se dire : je ne peux pas ne pas penser que je ne suis pas en mesure de penser. Je peux parler pour moi : la banque, la « financiarisation », c’est du chinois. Mais je suis concerné, comme tout le monde. Dans ce contexte, Olecha peut nous aider. Il fait partie des écrivains – je préfère dire des poètes – qui produisent un désenchantement positif. En ce sens, il répond à la fonction fondamentale du théâtre : mettre à nu, le temps de la représentation, les béquilles et les drogues qu’on s’offre pour survivre, dans la journée.
« L’Homme inutile… » n’est pas tendre pour l’expérience communiste. Vous êtes vous-même communiste…
On ne cesse de me le renvoyer, comme si on me collait une étiquette. Quand je vois Peter Stein, il me dit : « Alors, tu es encore communiste ? » Je lui réponds que si on veut être un intellectuel aujourd’hui, on ne peut pas ne pas être communiste. Parce qu’être communiste c’est avoir conscience qu’on fait partie d’une expérience partagée par toute l’humanité.
D’une certaine façon, on pourrait dire que je suis spinoziste, au sens où Spinoza écrit : l’expérience est une passion triste. On pourrait aussi dire que je suis pascalien. Etre communiste, c’est défendre ce qui caractérise l’être humain : le fait qu’il est capable de penser. C’est donc un enjeu totalement spirituel.
Cet enjeu, ne le trouveriez-vous pas ailleurs ?
Non. C’est exactement ce à quoi s’attaque la pièce d’Olecha. On y voit deux frères qui appartiennent l’un et l’autre au vieux monde. L’un d’eux, Andreï, a décidé de faire abstraction du fait qu’il est un aristocrate. Il dit : ce qu’il faut, c’est nourrir les gens. Son frère, Ivan, répond : la nature humaine ne se réduit pas au fait de manger. Je comprends qu’un parti puisse objecter : c’est vrai, mais tu ne peux pas penser si tu ne manges pas. Voilà le déchirement. Lénine en était très conscient. Il disait : faire la révolution, c’est facile, c’est s’attaquer à des montagnes. Mais les difficultés de la plaine, c’est autre chose.
On ne peut pas envisager le changement d’une société si la pensée a été mise au rancart. C’est de cela que Iouri Olecha rend compte. Il y a quelque chose qui ne va pas, dit-il. Comme le roi Lear, quand ses filles lui disent : tu as cent cinquante chevaux, tu peux te contenter de vingt. Elles lui font une comptabilité. Il leur répond : « Si vous ne traitez l’homme que dans la mesure de ce dont il a besoin, vous le traitez aussi mal qu’un animal. »
De la même manière que Shakespeare, Olecha met en cause et déséquilibre le bâti politique, qui, lui, doit se justifier. Il le fait en poète, et en son nom propre. Il sait trouver les métaphores pour nous parler de la situation de son époque, et nous renvoyer à celle d’aujourd’hui où l’on a rejeté la question de la masse et de l’individu, et où l’on voit, en Russie, des hommes formés au marxisme-léninisme qui deviennent des -oligarques.
Que pensez-vous de cette -évolution ?
Là encore, je citerai Spinoza : puisque ça est, c’est que ça devait être.
On pourrait vous opposer que c’est du fatalisme…
Non, au contraire. Il s’agit de se dire : c’est une étape, voyons ce qu’il en sort. Je pense que toute vie humaine est un laboratoire, et que, d’une certaine façon, il faut être heureux de vivre ce que l’on vit. J’espère simplement qu’en voyant la pièce d’Olecha, les gens penseront que l’histoire qu’il raconte les concerne.
Propos recueillis par Brigitte Salino
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/08/27/bernard-sobel-je-pense-qu-on-vit-dans-une-situation-d-angoisse-positive_1564329_3246.html