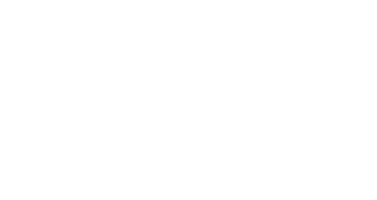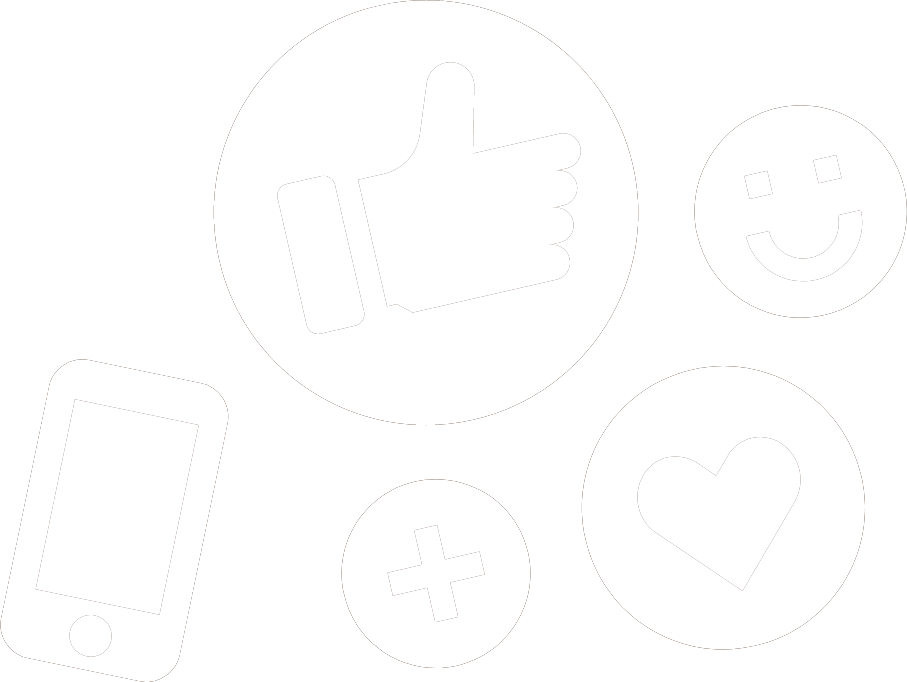Pour sauver la gauche, déprésidentialisons !
Par Michel Troper et Mikhail Xifara
Ça y est, nous y sommes. Dans un éditorial récent, un journal du soir jugeait plausible la disparition de la gauche aux prochaines élections présidentielles. C’est une mauvaise nouvelle : sans la gauche, toute contestation du néolibéralisme technocratique dominant ne trouverait plus à se dire que dans les mots de l’extrême droite. Il y a beaucoup à faire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mais aussi, peut-être, pour ne pas en arriver là. Un élément central de l’analyse nous semble être le fonctionnement des institutions. À trop se concentrer sur les rapports de force et les débats d’idées qui font la vie politique, on oublie que cette dernière est structurée par des dispositifs juridiques aux effets puissants. Ce sont ces dispositifs qui se transforment en piège mortel pour la gauche.
Jouer le jeu du présidentialisme pour exister ?
Dans le temps long, l’histoire constitutionnelle est marquée par la concentration des pouvoirs dans les mains de l’exécutif. Il prend dans notre pays la forme d’une pratique présidentialiste des institutions. Les défauts d’une telle pratique sont bien connus : la concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président et corrélativement, la réduction de la vie politique à la préparation de l’élection présidentielle à venir ; l’inévitable tension entre le président de la République et le Premier ministre, tantôt « collaborateur », tantôt rival ; la préoccupation exclusive pour la personne des candidats potentiels au détriment de leurs idées et de leurs programmes, si toutefois ils en ont ; le déclin des partis politiques qui ne sont plus que des machines à sélectionner les candidats. Les législatives servent à valider le choix effectué à la présidentielle et les parlementaires, redevables de leur poste au président, sont des godillots. Tout l’intérêt et l’importance de la politique s’en trouvent laminés.
Outre la tentation d’en user arbitrairement ou autoritairement, la concentration des pouvoirs entraîne paradoxalement une très grande difficulté à les exercer. Le président omnipotent reçoit la tâche impossible de changer la vie de ses concitoyens, tout seul depuis son bureau. Et comme il est responsable de tout, toute crise devient une crise de légitimité. De plus, cette concentration incite en permanence ceux qui ne peuvent s’exprimer à travers les institutions à descendre dans la rue. Ces défauts sont si bien connus qu’on multiplie les réformes censées la limiter (telles l’introduction des Questions prioritaires de constitutionnalité et la limitation au recours de l’article 49.3 dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) ou la contrebalancer par la prise en considération de l’opinion (grâce, par exemple, au référendum d’initiative partagée ou à des dispositifs à l’image de la Convention Citoyenne pour le Climat).
Causes du présidentialisme
Ces réformes échouent cependant, parce qu’elles ignorent que la concentration des pouvoirs n’est qu’indirectement liée à la Constitution. Le président ne tient pas son pouvoir des compétences que lui donne le texte constitutionnel, ni même de « l’onction » du suffrage universel, mais principalement de sa relation à la majorité parlementaire, dont il est le chef véritable (sauf en période de cohabitation). La domination qu’il exerce sur la majorité n’est pas non plus la conséquence de l’élection au suffrage universel (de Gaulle l’exerçait de la même façon avant la révision de 1962), ni même de l’organisation du calendrier, qui désormais fait suivre l’élection présidentielle de l’élection législative, puisque le droit de dissolution permettait à un président nouvellement élu de provoquer aussitôt les élections, comme le fit Mitterrand en 1981 et en 1988.
Ce qui permet au président de dominer la majorité, c’est que c’est lui qui la constitue. Si l’élection au suffrage universel ne lui donne pas à elle seule des compétences juridiques, elle a fait de lui un chef de parti : c’est lui qui désigne les candidats à la députation et fait de son programme présidentiel leur programme. De la sorte, ses députés une fois élus, lui devant leur siège et eux voulant mériter une nouvelle investiture à la fin de la législature, ne peuvent que le soutenir.
D’ailleurs, dans d’autres pays, bien que le président de la République soit élu au suffrage universel comme en France, c’est un Premier ministre émanant d’une majorité parlementaire qui exerce le pouvoir. C’est le cas au Portugal [1], en Autriche, en Finlande ou encore en Irlande. Comment est-il possible que, sur la base de textes semblables, les systèmes politiques fonctionnent aussi différemment ? L’explication est simple. Au Portugal par exemple, les candidats à l’élection présidentielle sont sans doute des hommes et femmes politiques, mais ils se sont éloignés des partis, y compris de leurs partis d’origine, et ils se présentent sans programme de gouvernement. Le président élu désignera le Premier ministre, mais ce sera celui que lui indiquera la composition de l’Assemblée.
Le présidentialisme n’est donc pas imposé par la Constitution elle-même. Mais il est vrai que cette dernière y incite fortement parce qu’elle donne à penser que, quel que soit le projet politique auquel on aspire, le seul moyen de le réaliser est de se faire élire président, ce qui transforme tout le reste de la vie politique en moyens pour y parvenir. C’est vrai à droite, bien sûr, mais aussi à gauche : les socialistes ne font plus semblant de penser à autre chose depuis des lustres. Chez les écologistes, céder à cette obsession est devenu un standard de maturité (ceux qui continuent à ne pas vouloir que la politique se réduise à une élection sont invités à « grandir »). Pour les communistes, présenter un candidat à la présidentielle serait l’acte ultime d’une nécessaire affirmation identitaire. Et toute la stratégie de La France insoumise (LFI) passe nécessairement par la case élyséenne. Tous, mais chacun à sa manière, peuvent bien dire ce qu’ils veulent à propos de la démocratisation des pouvoirs et la transformation des institutions, ils jouent le jeu du présidentialisme avec la dernière énergie. On voit pourquoi : puisque seule compte vraiment l’élection présidentielle, jouer le jeu du présidentialisme serait le seul moyen d’exister. Sauf que pour la gauche, c’est aussi le plus sûr moyen de se perdre.
La gauche et les institutions
La gauche est idéologiquement très diverse, c’est sa richesse et sa force. Elle est traversée de courants étatistes et anarchistes, centralistes et girondins, libéraux et interventionnistes etc. En matière d’institutions, et en simplifiant, la tension oppose une gauche démocratique (au sens de la démocratie radicale) et une gauche plus républicaine (au sens de la république sociale).
La gauche démocratique est critique de toute captation oligarchique des pouvoirs politiques et économiques ; elle tire son origine des traditions anarcho-syndicaliste, conseilliste ou mouvementiste. Elle se garde de tout dispositif de représentation politique, au motif que ceux-ci opèrent des transferts souvent indus de prérogatives politiques. Elle est particulièrement critique de la plus mystique de ces formes, « l’incarnation » qui identifie le collectif à son chef. Mais elle se méfie aussi de la forme mandataire, qui préside à l’élection de nos députés, comme de la « gestion d’affaire », permettant de déléguer les affaires publiques à des bureaucrates non élus. Elle préfère la société à l’État, le tirage au sort aux élections, les AG aux organisations et aux hiérarchies. En un mot, elle rêve de la diffusion et du partage des pouvoirs pour le plus grand nombre.
En face, ou plutôt à côté, la gauche républicaine n’hésite pas à identifier le peuple au corps électoral plutôt qu’aux manifestants, et n’a rien contre l’État s’il est populaire. Elle puise ses inspirations dans la tradition antimonarchique, mais se méfie de la critique du parlementarisme, qu’elle associe au fascisme. Cette gauche-là non plus ne veut pas être la dupe de la représentation qu’elle estime n’être qu’une fiction utile. Elle préfère donc vivement le mandat parlementaire à l’incarnation présidentielle, jugé moins mystique (entendre : moins monarchiste catholique), et surtout susceptible de contrôles divers, par lesquels les représentants doivent rendre des comptes à leurs électeurs. Pour elle, la bureaucratie est un mal nécessaire, qui doit être placé sous l’étroit contrôle du Parlement.
Malgré ces considérables divergences idéologiques, des compromis pratiques, qui offrent un socle commun aux diverses propositions de la gauche en la matière, ont toujours été possibles : revalorisation du Parlement, présidence faible, scrutin proportionnel, renforcement des mécanismes de contrôle des élus et de l’initiative populaire, législative ou constitutionnelle, par voie référendaire, droit de pétition etc. La gauche démocratique y voit une manière de substituer des procédures participatives aux institutions représentatives, la gauche républicaine une manière de revitaliser ces dernières, mais les deux, ayant lu Brecht, se félicitent de l’effet de distanciation obtenu. Chacun voit donc les choses à sa manière, mais c’est assez pour se rassembler.
Surtout, c’est assez pour distinguer très clairement la gauche des forces qui rejettent en bloc toute forme d’institutionnalisation de la vie politique, et qui se manifestent ces temps-ci dans les velléités de candidatures de bouffons. C’est en effet une chose que de considérer que la représentation est une fiction parfois utile et parfois pas, c’en est une autre que de nier la nécessité de se doter de règles stables pour organiser la vie collective. Ce socle distingue aussi la gauche de certaines forces sociales-libérales qui, ayant entièrement abdiqué toute critique du présidentialisme, ne sont plus de gauche.
Le dilemme et le piège
Un tel contexte rend évidemment l’injonction présidentialiste de « se rassembler derrière un chef » beaucoup plus difficile à accepter pour la gauche que pour la droite. La difficulté à faire l’unité autour d’une candidature commune ne tient pas, comme on l’entend souvent, aux égos (pas plus pétulants à gauche qu’à droite), ou aux querelles de chapelles. À gauche comme à droite, la politique est aussi question de personnes et de partis, et c’est bien normal : LFI juge qu’un candidat socialiste trahirait les milieux populaires, les socialistes qu’un candidat radical serait incapable de l’emporter, les écologistes se méfient de l’étatisme de LFI… tous ont raison de leur point de vue. Mais tous ont aussi beaucoup à perdre lorsqu’il faut s’unir derrière un allié dont on se méfie.
Les partis de gauche doivent donc choisir entre perdre leur spécificité en s’unissant derrière un concurrent ou s’affaiblir en renforçant la division. Et ceux des partis qui le peuvent rêvent de sortir du dilemme en étant celui derrière qui on s’unit. La gauche est certes parvenue à l’unité en 1981, derrière Mitterrand, mais nombreux sont ceux qui pensent que l’expérience a bien plus changé la gauche que les institutions, et qu’elle marque le début de son déclin, parce que l’unité s’est faite au prix du sacrifice de sa diversité, qui est aussi sa richesse.
Il est vrai que, depuis, LFI propose une « formule » assez nouvelle, celle du « populisme de gauche », selon laquelle le chef est censé être une sorte de « médiateur évanouissant », destiné à cristalliser les forces pour les conduire à la victoire et ensuite à disparaître dans l’initiation d’un nouveau « moment constituant », conduisant à l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont la pierre angulaire est de dépouiller le président de ses pouvoirs. La formule est intéressante et audacieuse, mais elle se heurte à la structure du système (qu’elle ignore superbement). Mais on voit mal comment le « chef de gauche » devenu président ne serait pas immédiatement assiégé par de nombreuses et puissantes forces conservatrices, ni comment, dans ce contexte, il pourrait vouloir sacrifier les rares leviers dont il dispose, à commencer par ses prérogatives. On imagine en revanche fort bien comment il se résoudrait en tout bonne foi à jouer de tous les pouvoirs que lui confère la pratique présidentialiste des institutions. Il ne tarderait donc pas à devenir, plutôt que le « médiateur évanouissant » d’un nouveau processus constituant, un président comme les autres, un monarque élu. Comme à chaque fois qu’un « chef de gauche » a gagné. Non seulement la gauche ne peut s’unir derrière un chef qu’en s’affaiblissant, mais en gagnant, elle se renie, parce que sa victoire signe le renoncement à mettre en œuvre ses projets institutionnels.
La gauche est donc placée devant un dilemme : accepter d’être une « gauche de gouvernement » en faisant le contraire de ce qu’elle dit, ou rester de gauche en se contentant d’exercer une « fonction tribunicienne » qui acte son impuissance à changer la société. Depuis 1983, ce dilemme s’est transformé en un piège dont la gauche ne pourra se sortir sans changer préalablement le système. Il est grand temps d’en prendre acte.
Une proposition pour sortir du piège
Il faut commencer par se rappeler que le système conditionne les comportements et les représentations sans les déterminer entièrement. On peut donc chercher à le subvertir de l’intérieur. La stratégie consiste alors à jouer avec les marges de manœuvre pour en créer de nouvelles plus larges et ainsi de suite. Concrètement, si le régime est présidentialiste, c’est parce que le président nouvellement élu est aussi le chef de la majorité parlementaire. Mais cette confusion n’est elle-même rendue possible que parce que l’ensemble des acteurs, y compris de gauche, ont l’esprit tellement colonisé par les pratiques présidentialistes qu’ils sont devenus incapables de s’imaginer changer le pays autrement qu’en gagnant la présidentielle. Ne pas céder à ce renoncement, qui commande tous les autres, consiste à penser contre le présidentialisme de l’intérieur même de la Ve République.
Une proposition
Plusieurs idées sont possibles. On pourrait par exemple imaginer que la gauche refuse de présenter un candidat à la présidentielle pour se concentrer sur les législatives. Cette solution aurait le mérite d’ouvrir une campagne politique contre le présidentialisme et de redonner de la cohérence aux partis de gauche. Elle aurait le désavantage dirimant de laisser un boulevard à la droite et à l’extrême droite.
Dans une tribune publiée par Libération, nous avons proposé que les forces de gauche s’accordent pour embaucher un acteur, ou une actrice, pour se présenter en leur nom. Rien à voir avec la candidature plus ou moins spontanée d’un bouffon anti-establishment, puisque cet acteur·trice est présenté·e par les partis de gauche et s’engage à faire campagne sur les éléments que chacun de leurs programmes ont en commun. Cette campagne devra d’ailleurs être entièrement dirigée par un comité unitaire créé à cette fin. Ce comité aura pour tâche d’élaborer non pas un véritable programme de gouvernement, mais tout au plus une plate-forme électorale commune, assortie de diverses options. C’est assez pour mener campagne de manière crédible et de nombreuses initiatives récentes montrent que la convergence nécessaire à sa conception n’est pas hors de portée (même sur des sujets aussi difficiles que la croissance ou l’Europe [2]). Chaque parti pourra faire campagne sur ses thèmes de prédilection. Certains choix d’options et arbitrages peuvent être laissés en suspens, dans l’attente que le rapport entre les forces de gauche soit scellé par les législatives. Et c’est alors seulement qu’on pourra s’accorder sur le choix du Premier ministre, l’attribution des ministères et le programme définitif du gouvernement.
Bien sûr, tout ceci suppose non seulement que la gauche gagne les élections législatives mais aussi qu’elle parvienne à former une coalition gouvernementale. C’est le but de notre proposition. Si la droite devait gagner, ce serait à elle de former une coalition ; notre proposition aurait échoué à faire revenir la gauche au pouvoir, mais aurait tout de même le mérite de nous avoir sortis du présidentialisme. Et si la gauche devait gagner sans réussir à s’unir, notre proposition aurait aussi échoué, mais il serait toujours possible d’élargir le spectre de la coalition pour trouver une majorité de gouvernement.
Cette proposition nous paraît idéologiquement, politiquement et juridiquement intéressante.
Idéologiquement, une telle candidature redonnera des couleurs à la gauche, en replaçant la question de la représentation, et de sa fétichisation, au centre du débat politique. L’acteur·trice dira les discours qu’on lui écrira, défendra la plate-forme électorale des partis qui la soutiennent, mais surtout, rappellera une vérité importante : il ou elle n’est qu’un·e acteur·trice, qui n’incarne ni une majorité parlementaire ni le peuple. Élu·e, il ou elle sera mandaté·e par lui, mais ce mandat ne le ou la confondra pas avec ses mandataires. Sa simple existence rappellera que le représentant n’est pas le représenté, ou pour le dire avec Magritte, que « ceci n’est pas une pipe ». Du point de vue de la gauche démocratique, il s’agira de renouer avec une tradition de subversion des institutions, comme quand le Parti communiste (PC) présentait en 1925 aux élections municipales des femmes, non éligibles à l’époque, pour exiger que celles-ci le deviennent.
Du point de vue de la gauche républicaine, il s’agira de revenir à ses sources antimonarchiques, comme lorsque Condorcet, à qui l’on objectait la nécessité de préserver la monarchie, proposait alors de remplacer le Roi par un automate [3]. Cette solution dit en effet, mieux que tout discours, ce que nos concitoyens expriment déjà fort bien par l’abstention ou autour des ronds-points, que la France n’a pas besoin d’un « chef », encore moins d’un « père », et peut-être pas même d’un président ; que la démocratie n’est pas non plus tout à fait soluble dans la représentation, qui n’est qu’une fiction parfois utile, mais pas toujours ; que la politique est aussi une mise en scène, un jeu sérieux auquel on peut jouer sérieusement sans croire aux fictions qui le fondent, en y jouant même d’autant mieux qu’on n’y croit pas.
Politiquement, notre proposition a le mérite de faciliter le rassemblement de la gauche autour d’une candidature unique, sans sacrifier sa diversité, puisque chacun de ses leaders fera campagne sur son propre programme, dans le cadre de la plate-forme électorale commune. Ils feront ainsi vivre le pluralisme de la gauche, sans sacrifier à l’unité nécessaire pour conquérir des majorités d’idées et des rapports de force. De fait, la campagne des présidentielles serait surtout le prologue de la mère des batailles, les législatives.
Elle permet en outre de sortir d’un autre vice du présidentialisme, la personnalisation de la vie politique. Sans doute, journalistes et opposants attaqueront notre acteur·trice sur son engagement. Il est pourtant limpide : il ou elle est là pour faire son métier, réciter son script. Sa vie privée, son opinion personnelle ne touchent pas à la question : il ou elle se contente de mettre en scène, le mieux possible, la plate-forme électorale de la gauche. Il ou elle peut donc même faire la une de Paris-Match si on le lui propose : cela n’apprendra rien aux électeurs des idées qu’il ou elle joue à défendre.
Une telle candidature offre encore une alternative crédible à celle des clowns, qu’il s’agisse de ceux dans la lignée de Berlusconi et Trump ou dans celle de Coluche et Bigard. L’acteur·trice partage certes avec eux certains talents, et éventuellement la notoriété. Mais sa candidature signifie le contraire de l’effondrement du politique dans l’avènement de la souveraineté grotesque telle que décrite par Foucault [4]. Elle ne vise pas à destituer les institutions en les moquant, mais au contraire, et très explicitement, à mettre leurs rouages en lumière en les faisant jouer au service d’un projet de transformation du régime. Il s’agit bien de mettre en scène une fiction, mais cette fiction est éminemment politique et elle n’est pas une farce.
Cette proposition a encore le mérite de se situer assez précisément au point d’intersection des gauches démocratique et républicaine pour espérer qu’elle soit non seulement acceptable, mais hautement désirable pour l’une comme pour l’autre, à la condition bien sûr que l’une et l’autre veuillent bien se souvenir qu’elles sont radicalement opposées au présidentialisme.
Juridiquement, cette proposition est robuste. Il faut certes éviter de signer un contrat en bonne et due forme, ce qui suppose de trouver un acteur ou une actrice qui accepte ce rôle par conviction. Ce qui compte surtout, c’est qu’il ou elle ait le soutien des partis, donc du comité unitaire. Ce soutien rendrait facile la collecte des signatures, comme le financement de la campagne électorale.
Mais que se passera-t-il si l’acteur·trice gagne ? Ne disposera-t-il ou elle pas de pouvoir immenses ? Il faut rappeler avant tout que les pouvoirs d’une autorité quelconque procèdent de la Constitution, et que ceux que la Constitution de 1958 confère au président sont limités. Certes, de Gaulle a joué avec l’idée que le président « procède » du peuple et le Premier ministre du président, comme l’Esprit procède du Père et du Fils pour ne faire qu’un avec lui, mais une relation mystique ne confère par elle-même aucun pouvoir.
Les pouvoirs du président sont limités avant tout par le principe que les actes du président doivent-être contresignés par le Premier ministre, ce qui signifie que le Premier ministre, en refusant, peut entraîner la nullité de ces actes. C’est ce qui explique le développement du régime parlementaire, et aussi pourquoi, en période de cohabitation, le président doit céder l’essentiel de son pouvoir au Premier ministre.
Il est vrai que certains actes sont dispensés du contreseing, mais comme nombre de ces derniers présupposent la participation décisionnelle d’une autre autorité [5], le risque de voir notre acteur·trice user de ces actes pour se lancer dans une aventure personnelle est limité.
De fait, le président n’exerce seul que deux pouvoirs très importants : le droit de dissolution et le fameux article 16. Il en va cependant du droit de dissolution comme de beaucoup d’autres : il ne suffit pas d’en disposer pour être en mesure de s’en servir. Or, le président n’a aucun intérêt à dissoudre s’il n’a pas la possibilité de disposer d’une majorité à l’issue des élections qui suivront. À chaque fois que le président a prononcé la dissolution, c’était parce qu’il avait un espoir de disposer d’une majorité cohérente et disciplinée. Et quand il a mal mesuré ses chances, comme Mac Mahon ou Chirac, l’on a vu ce qu’il lui en a coûté. Notre acteur·trice élu·e, quand bien même il lui prendrait la fantaisie de vouloir réellement exercer le pouvoir politique, aurait les plus grandes difficultés à prendre la tête d’un mouvement à vocation majoritaire, n’ayant aucune autonomie politique propre. Quant à l’article 16, il n’est pas d’un maniement facile, même pour un apprenti dictateur, s’il ne dispose pas de réseaux dans l’administration et dans l’armée. Même Trump, quand il est allé trop loin, s’est heurté au refus d’obéissance de ceux qui jusque-là, semblaient lui être dévoués.
Bref, si les aventures personnelles sont toujours possibles, notre proposition a le mérite de les rendre beaucoup plus difficiles que ne le fait la configuration actuelle. Il y a donc fort à parier que si l’acteur·trice gagne, il ou elle se trouvera dans la même situation que le président du Portugal [1]. Il ou elle n’aura pas présenté de programme de gouvernement, n’aura pas été à la tête d’un parti ni même d’une coalition et n’aura pesé en rien sur les élections législatives, qui verront s’affronter des partis. Les élections législatives se dérouleront selon le mode de scrutin actuel. La gauche, forte de sa victoire, aura de bonnes chances de les gagner, et même si aucun de ses chefs ne peut gagner une élection présidentielle, chacun d’eux pourra peser lourd dans une coalition parlementaire. Cette dernière choisira un Premier ministre qui gouvernera le pays, attribuera les ministères et s’accordera sur un programme définitif de gouvernement.
Objections à notre proposition
Après la publication de notre tribune, nous avons reçu de nombreuses remarques et objections. Répondre à quelques-unes permet de préciser le sens de notre démarche.
La première, et la principale, est évidemment que cette proposition « n’est pas réaliste ». Il est vrai que cette proposition paraît utopique. Ce n’est déjà pas si mal. En effet, une « proposition utopique » n’est pas seulement une proposition concrètement irréalisable, c’est aussi une proposition destinée à dévoiler un impensé idéologique. En l’espèce, nombreux sont ceux qui, même à gauche, trouvent que toute proposition sortant trop du jeu ordinaire du présidentialisme n’est « pas réaliste ». Ils devraient commencer par se demander de quoi leur réticence est le symptôme. Surtout, notre proposition n’est pas seulement utopique. Elle est réaliste parce qu’elle est concrètement réalisable sur le plan institutionnel. Et « concrètement réalisable » ne veut pas seulement dire qu’il suffirait qu’on l’adopte pour la réaliser, mais qu’il est dans l’intérêt de tous les dirigeants des partis de gauche de l’adopter.
Ceux de ces dirigeants qui ne peuvent pas espérer gagner la présidentielle y ont intérêt, parce qu’elle évite que leur poids dans la coalition finisse dilué dans la « majorité présidentielle » godillot après leur échec aux élections. Ainsi, Monsieur Roussel (secrétaire national du PCF ) trouvera aux législatives l’occasion d’affirmer l’existence de son parti, sans risquer une déroute à la présidentielle. De même, s’il fut un temps où les écologistes pouvaient vouloir miser sur une élection nationale du fait de leur faible implantation locale, ils n’ont désormais plus à craindre que l’élection législative soit l’épreuve décisive.
Ceux des dirigeants qui peuvent espérer gagner la présidentielle y ont aussi intérêt, parce que la proposition permet d’éviter que leur candidature fasse courir un risque mortel à toute la gauche, et parce que la victoire de l’acteur·trice leur permet d’espérer raisonnablement prendre la tête de la majorité parlementaire de gauche en gagnant les législatives. Leur leader deviendra alors Premier ministre et gouvernera le pays sans être entravé par le président, désormais dépourvu de pouvoirs réels. Certes, Madame Hidalgo, Monsieur Mélenchon ou Monsieur Jadot devront renoncer à prétendre « incarner la France », mais en démocratie, on peut gouverner sans prétendre incarner quoi que ce soit.
Enfin, tous les dirigeants des partis de gauche y auraient intérêt, parce qu’au lieu de se faire concurrence et de brouiller leur message en s’affaiblissant mutuellement, en mettant leurs forces au service de la victoire de l’acteur·trice, ils placeront donc leur parti en position de peser d’un poids réel dans le futur gouvernement, qui sera proportionnel à leur force, mais augmenté par la dynamique unitaire. Tous peuvent au moins prétendre à un grand ministère. On s’accordera que c’est mieux que de perdre dans la division.
Notre proposition est donc réaliste. Elle le serait du moins, si les leaders de la gauche étaient capables de se décoloniser l’esprit et d’agir conformément à leurs intérêts. Mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas. Non pas parce que ce sont de mauvais dirigeants aveuglés par leur égo et leur chapelle, mais parce que la politique n’est pas tant affaire de calculs rationnels que de passions, d’habitudes et de préjugés. Et c’est vrai que, si notre proposition supposait que les dirigeants de la gauche puissent faire abstraction de leurs passions, habitudes et préjugés, elle serait tout à fait irréaliste, parce que cela n’arrivera jamais.
Ce qui arrivera vraisemblablement, c’est que les dirigeants de la gauche se présenteront à l’élection présidentielle en ordre dispersé, dans l’espoir qu’en « tuant le match », ils imposent aux autres candidats de se rallier à eux, jusqu’à rassembler assez de voix pour être présents au second tour. Mais on sait déjà que jouer à « tuer le match » est une stratégie hasardeuse, dont la gauche elle-même risque de ne pas sortir vivante.
Mais c’est à ce moment précis que notre proposition pourrait redevenir tout à fait « réaliste ». Imaginons que quelque part dans les mois à venir, tous les candidats déclarés constatent qu’ils plafonnent autour de 10 % et que la division a tellement démobilisé les électeurs que la somme de leurs voix est ridicule. Imaginons donc qu’ils se rendent compte qu’ils n’ont pas tué le match, mais que le match les a tués. Peut-être seront-ils alors aveuglés par l’espoir d’un redressement ultime et héroïque, et persévèreront-ils jusqu’au bout dans leur stratégie. Mais peut-être se rendront-ils compte qu’ils sont en train de se suicider politiquement, en sacrifiant durablement la gauche. Peut-être surtout sentiront-ils la pression d’un électorat mobilisé en faveur de l’union. Et peut-être se demanderont-ils alors comment sortir du piège où ils se sont placés eux-mêmes. Peut-être alors se réuniront-ils pour discuter désistements, programme et répartition des places. Ils achopperont alors nécessairement sur la répartition de la seule place qui compte, celle de président. Et là, notre proposition est à leur disposition pour dénouer la situation, en choisissant d’échanger la chronique d’une défaite présidentielle annoncée contre une chance de succès parlementaire. C’est réaliste.
Deuxième objection : « Vous ne vous rendez pas compte, pour se présenter à la présidentielle, il faut être un guerrier de l’espace ». N’ayant jamais vécu de présidentielle de l’intérieur, ceci est vrai : nous ne nous rendons pas compte. Et nous sommes prêts à entendre que le degré de fatigue et de pression, la perversité des coups fourrés, le poids des responsabilités sont tels que non seulement cette élection rend fou, mais qu’elle exige de ceux qui osent s’y lancer qu’ils soient préalablement très névrosés. Ne s’improvise pas leader charismatique qui veut. Il faut savoir déjouer les coups fourrés, fourrer les coups, vivre légèrement les plus lourdes responsabilités, endurer avec entrain la fatigue et la pression, prendre les bonnes décisions, séduire et convaincre. Être un guerrier de l’espace.
L’acteur·trice endurerait fatigue et pression, devrait séduire et convaincre mais n’aurait ni à fourrer les coups, ni à porter les responsabilités, ni même à décider, puisque les chefs aguerris du comité unitaire de campagne s’en chargeraient. Notre proposition n’ôte donc rien à la violence ordinaire de la vie politique, mais cette violence sera endurée non pas tant par l’actrice que par les dirigeants des partis de gauche qui la soutiennent. Voter pour lui ou elle, c’est en effet voter pour eux. Ce qui réduirait d’autant l’intérêt des adversaires de s’attaquer directement à lui ou à elle.
Objection numéro trois : « L’acteur·trice vous trahira parce que le pouvoir corrompt ». En politique, la trahison est toujours possible. Les exemples historiques de corruption par le pouvoir sont légion et personne ne peut savoir ce que le thrill de la victoire est capable de produire dans la psyché de l’acteur·trice. Mais pour vouloir exercer du pouvoir, il faut commencer par en avoir un peu, ou du moins espérer en avoir. Ce ne sera pas le cas : l’acteur·trice n’aura aucune chance de pouvoir contrôler les parlementaires de gauche, qui doivent leur poste à leur parti et non pas à lui ou elle. Il ou elle n’aura aucun moyen de pression sur le Premier ministre. En revanche, la majorité parlementaire de gauche pourrait réduire drastiquement le budget de l’Élysée, une éventualité que notre acteur·trice devra ne pas oublier quand il ou elle se sentira pousser des ailes.
Quatrième objection: « Votre proposition est sexiste ». Il faut l’admettre. Mais nous sommes pris dans une contradiction, qui n’est pas seulement la nôtre. Si nous proposons que notre acteur·trice soit un acteur, nous reconduisons servilement le virilisme avilissant qui domine nos représentations ordinaires : pour être sérieusement un « guerrier de l’espace », il faudrait être un homme. L’élection présidentielle ne serait gagnable que dans un grand déploiement de testostérone, les Français ne peuvent accorder leur confiance qu’à une figure paternelle, etc. Mais si nous proposons que notre acteur soit une actrice, comment éviter le reproche que c’est précisément au moment où il s’agit de transformer le président en potiche impotente qu’on pense aussi à féminiser la fonction ? Il n’y a aucun moyen d’échapper à cette contradiction, qui nous ennuie puissamment. Pour notre part, nous serions enclins à préférer que ce soit une femme, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de voir la gauche nous doter d’une présidente pour la première fois dans l’histoire du pays. Mais comment nier que cette solution verse dans le stéréotype de la plante verte ? En tout état de cause, le comité unitaire de campagne aura là une décision difficile à prendre.
Cinquième et dernière objection : « Vous voulez restaurer le parlementarisme, le retour à la IVe république ». Il y a au moins deux manières de répondre à cette objection : la première, que la gauche républicaine ne désavouera pas, consiste à défendre la IVe république. La seconde, qui devrait avoir la préférence de la gauche démocratique, s’attache à souligner que l’élection de l’acteur·trice est susceptible d’ouvrir une phase de créativité politique nouvelle, et pas seulement de restaurer le parlementarisme.
Cette objection correspond à une conception très répandue chez les juristes, selon laquelle l’histoire constitutionnelle française obéirait à des lois. L’évolution aurait d’abord été cyclique : entre 1789 et 1815, la France serait passée de la monarchie constitutionnelle à la République puis à l’Empire, et cette succession se serait répétée entre 1815 et 1852. Elle serait devenue linéaire à partir de 1870 : chaque régime marque un progrès par rapport au précédent, la IVe cherchant vainement à corriger les défauts de la IIIe. C’est seulement avec la Ve que la France connaîtrait enfin un système stable, efficace et conforme aux idéaux de l’État de droit et de la démocratie. Difficile de ne pas voir dans ce récit une justification ad hoc des institutions présentes plutôt qu’une interprétation crédible de l’histoire.
Mais que reproche-t-on au juste à la IVe République ? Si l’on met à son crédit la reconstruction, l’expansion économique et la protection sociale, on lui impute l’échec de la décolonisation (mais c’est certainement trop attribuer aux institutions politiques de la métropole dans l’affaire). Quant aux vices de ces institutions elles-mêmes, on souligne l’instabilité ministérielle, l’omnipotence du Parlement et sa propension à abandonner au gouvernement une grande partie de son pouvoir, faute de pouvoir l’exercer. Sur ce dernier point, il faut rappeler que c’est là un trait commun à tous les parlements du monde et qu’on le retrouve encore plus accentué sous la Ve République. Quant à l’instabilité ministérielle, elle est incontestable, mais elle était due moins au dispositif constitutionnel qu’à la présence à l’Assemblée nationale de groupes importants, le RPF et le PC, qui n’entraient dans aucune coalition, avec pour conséquence qu’un gouvernement ne pouvait se former et se maintenir qu’avec le soutien de presque tous les autres. Si l’instabilité a disparu après 1958, ce n’est pas tant par le miracle de l’article 49.3 ou par la menace de la dissolution que grâce à la présence quasi constante d’une majorité. Mais c’est au prix de l’abaissement du Parlement et de cette majorité elle-même.
Au final, l’expérience de la IVe République a fait croire, à tort, que le parlementarisme conduisait inéluctablement à l’instabilité. Il y a pourtant bien des États, de l’Allemagne au Portugal, dans lesquels les parlements parviennent à dégager des majorités et même des majorités de coalition qui permettent de gouverner de façon équilibrée.
Si la restauration du parlementarisme ne signe pas forcément le retour de l’instabilité ministérielle, il faut noter qu’elle ne suffit pas non plus à garantir contre la concentration et la personnalisation du pouvoir (voir Netanyahu en Israël), encore qu’elle contribue à compliquer singulièrement l’accaparement monarchique des pouvoirs. Mais il faut surtout noter que cette restauration est un socle à partir duquel le régime peut évoluer dans plusieurs directions, y compris celle de la réalisation des projets les plus audacieux de la gauche.
Aujourd’hui, ces projets se disent surtout dans les termes d’une « VIe République » qui se substituerait à la Constitution de la Ve. Et si l’on peut changer de régime sans changer le texte constitutionnel, on peut aussi vouloir changer le texte pour aller plus loin dans le partage et le contrôle des pouvoirs. La victoire de l’acteur·trice serait donc synonyme de restauration du parlementarisme sans changer la constitution, mais serait aussi susceptible d’ouvrir une phase nouvelle de créativité politique. Tous les projets actuels de VIe République ont en effet pour socle un régime parlementaire monocaméral, auquel sont associés des dispositions de contrôle strict des élus (renouvellement et contrôle régulier des mandats, recall etc.) et de démocratie participative (initiative législative et référendaire populaire, droit de pétition, conventions citoyennes tirées au sort). Parce que tous ces projets visent aussi à neutraliser le pouvoir politique du président, aucun n’est crédible s’il doit être porté par un président fort pour être réalisé. Il peut en revanche être porté par le Premier ministre et sa majorité parlementaire, si le président est notre acteur·trice.
Rien n’interdit en effet à la majorité de gauche au Parlement de vouloir modifier la Constitution. Suite à l’élection de l’acteur·trice, les forces de gauche majoritaires au Parlement doivent pour ce faire obtenir le vote d’un projet de révision dans chaque chambre, puis les trois cinquièmes du Congrès ou bien l’adoption par référendum. Une voie difficile, étant donné la composition du Sénat. Une autre option serait, plutôt que de réviser la Constitution, de convoquer une Assemblée constituante ; il faudrait cependant au préalable réviser la procédure de révision, avec les mêmes difficultés. Une troisième solution consisterait à soumettre le projet directement au référendum (article 11 de la Constitution), sans passer par le Parlement, comme de Gaulle l’a fait en 1962. L’initiative appartiendrait à l’acteur·trice (sur proposition du Premier ministre) ou à défaut à l’initiative de la majorité de chacune des deux chambres. La constitutionnalité de cette démarche est certes très incertaine, et le Conseil constitutionnel pourrait vouloir la bloquer (encore que sa compétence en la matière soit elle aussi très incertaine [6] et qu’il n’ait pas jugé bon d’en faire usage en 1962 et en 1969). S’il devait s’opposer à son adoption, il ouvrirait un conflit politique dont l’issue est indécise.
Ce qui est certain, c’est qu’un tel changement de la Constitution ne pourrait reposer que sur un mouvement populaire puissant, difficile à imaginer quand on regarde le paysage politique actuel. Il est aussi certain que, pour s’engager dans une telle bataille sans craindre de la voir déboucher sur un épisode césariste, il est très préférable que le président soit préalablement dépouillé de l’essentiel de sa capacité politique d’agir. Non seulement notre proposition n’interdit pas les audaces de la gauche démocratique, mais en les délestant du risque autoritaire qu’elles portent, elle répond aux craintes que la gauche républicaine nourrit à leur endroit. Autrement dit, là encore, notre proposition est susceptible de se situer au point d’intersection des deux traditions constitutives de la gauche : celle qui n’a rien contre la IVe et celle qui préfèrerait en inventer une VIe.
Quant à la droite, il est bien difficile de prévoir sa réaction à une victoire de l’acteur·trice. Certains se féliciteront d’un possible retour au parlementarisme. Après tout, il n’y a pas qu’à gauche qu’on pense que l’hyper-concentration du pouvoir conduit à l’impotence et que la vie politique mérite mieux qu’une course de chevaux. D’autres, sans aucun doute, souhaiteront le retour du présidentialisme. Certains se féliciteront d’un changement de constitution favorable au Parlement, à la proportionnelle et aux initiatives populaires, d’autres y verront une catastrophe. L’essentiel ici est précisément que chacun des scénarios rendus possibles par l’adoption de notre proposition sont aussi susceptibles de trouver de forts soutiens à droite. Et qu’en tout état de cause, les institutions fonctionneront.
On l’aura compris, notre proposition est modeste. Elle vise seulement à porter un coup d’arrêt à la pratique présidentialiste, sans avoir au préalable à changer de constitution. Si elle devait fonctionner, nous serions toujours sous la Ve République, mais dans sa version parlementaire. Elle serait en outre susceptible d’ouvrir un nouveau chapitre de notre vie politique. Nous ne prétendons certes pas transformer le système politique par un simple artifice politico-juridique. Mais nous prétendons que cet artifice, ou un autre qui serait meilleur, permettrait à la gauche de sortir du piège mortel dans lequel elle se trouve, permettrait aux institutions existantes de mieux fonctionner et offrirait une possibilité intéressante à ceux qui veulent les changer. Et puis quelle est l’alternative : la défaite ou la fausse victoire sur un coup de chance ? Qu’a-t-on à perdre à essayer ? Pas grand-chose, on est déjà presque mort.
[1] Au Portugal, dont la constitution a été inspirée par la Constitution française, le président de la République y est élu comme en France, au suffrage universel à deux tours, également pour cinq ans. Il a même des pouvoirs plus importants que le président français, par exemple un droit de veto législatif, qui, pour les textes les plus importants, ne peut être surmonté qu’à la majorité des deux tiers, ou le droit de révoquer le Premier ministre dans certaines conditions. Et pourtant, ce président n’exerce qu’une magistrature d’influence, comparable à celle du président de la République italienne ou du président de la IVe République française.
[2] Pour une mise au point récente : Abel Mestre et Sylvia Zappi, « Union de la gauche, la partie d’échecs continue », Le Monde, 10 février 2021. Voir aussi ces initiatives de la société civile : Nabil Wakim et Sylvia Zappi, « De la CGT à Greenpeace, une alliance inédite entre syndicats et mouvements écologistes », Le Monde, 26 mai 2020. Voir encore, autre autres, les initiatives pour une candidature commune à gauche : « 2022, (vraiment) en commun » : l’appel d’élus et activistes de gauche à « une alternative écologique, sociale et démocratique » au néolibéralisme pour la présidentielle sur France Info le 10 octobre 2020 ou encore l’appel à un « Big Bang de la gauche » dans Le Monde, Abel Mestre, 29 juin 2019.
[3] Condorcet, « Lettre d’un jeune mécanicien », Œuvres de Condorcet, tome 12, Didot, 1847, p. 251-253.
[4] Michel Foucault, « Cours du 8 janvier 1975 », in Les anormaux, Cours au collège de France 1974-1975, Paris, EHESS, Gallimard-Seuil, 1999. Pour une reprise de ces thèses au soutien d’une analyse de la présidence Trump, voir l’article de Christian Salmon, « L’hyperréaliste du bouffon — Trump et l’élection de 2020 », AOC, 5 novembre 2020.
[5] Le président de la République peut soumettre au référendum certains projets de loi (mais seulement sur proposition du Premier ministre ou des assemblées) ou un projet de révision constitutionnelle (mais uniquement après un vote par les deux assemblées en termes identiques). Il nomme seul le Premier ministre ou met fin à ses fonctions, mais il est de fait contraint de le choisir dans la majorité parlementaire. Il peut saisir le Conseil constitutionnel d’un traité international ou d’une loi qui vient d’être adoptée, mais ce sera la juridiction qui décidera de leur validité.
[6] Le Conseil constitutionnel se juge compétent pour contrôler le décret de convocation des électeurs, au fondement de l’article 60 de la Constitution qui lui confie « la charge de veiller au bon déroulement des opérations de référendum ». Mais la nature et la portée de ce contrôle restent très débattues pour ce qui concerne un référendum constituant – voir Jean-Marie Garrigou-Lagrange, « Les contrôles du Conseil constitutionnel sur les décrets de convocation des électeurs au référendum », Les Petites affiches, 2002, n° s.n., p. 4-12.
Juriste, Professeur émérite de droit public, Université Paris-Nanterre
Juriste, Professeur de droit public, École de droit de Sciences Po
Pour sauver la gauche, déprésidentialisons !
Par Michel Troper et Mikhail Xifaras
publicité
Ça y est, nous y sommes. Dans un éditorial récent, un journal du soir jugeait plausible la disparition de la gauche aux prochaines élections présidentielles. C’est une mauvaise nouvelle : sans la gauche, toute contestation du néolibéralisme technocratique dominant ne trouverait plus à se dire que dans les mots de l’extrême droite. Il y a beaucoup à faire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mais aussi, peut-être, pour ne pas en arriver là. Un élément central de l’analyse nous semble être le fonctionnement des institutions. À trop se concentrer sur les rapports de force et les débats d’idées qui font la vie politique, on oublie que cette dernière est structurée par des dispositifs juridiques aux effets puissants. Ce sont ces dispositifs qui se transforment en piège mortel pour la gauche.
Jouer le jeu du présidentialisme pour exister ?
Dans le temps long, l’histoire constitutionnelle est marquée par la concentration des pouvoirs dans les mains de l’exécutif. Il prend dans notre pays la forme d’une pratique présidentialiste des institutions. Les défauts d’une telle pratique sont bien connus : la concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président et corrélativement, la réduction de la vie politique à la préparation de l’élection présidentielle à venir ; l’inévitable tension entre le président de la République et le Premier ministre, tantôt « collaborateur », tantôt rival ; la préoccupation exclusive pour la personne des candidats potentiels au détriment de leurs idées et de leurs programmes, si toutefois ils en ont ; le déclin des partis politiques qui ne sont plus que des machines à sélectionner les candidats. Les législatives servent à valider le choix effectué à la présidentielle et les parlementaires, redevables de leur poste au président, sont des godillots. Tout l’intérêt et l’importance de la politique s’en trouvent laminés.
Outre la tentation d’en user arbitrairement ou autoritairement, la concentration des pouvoirs entraîne paradoxalement une très grande difficulté à les exercer. Le président omnipotent reçoit la tâche impossible de changer la vie de ses concitoyens, tout seul depuis son bureau. Et comme il est responsable de tout, toute crise devient une crise de légitimité. De plus, cette concentration incite en permanence ceux qui ne peuvent s’exprimer à travers les institutions à descendre dans la rue. Ces défauts sont si bien connus qu’on multiplie les réformes censées la limiter (telles l’introduction des Questions prioritaires de constitutionnalité et la limitation au recours de l’article 49.3 dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) ou la contrebalancer par la prise en considération de l’opinion (grâce, par exemple, au référendum d’initiative partagée ou à des dispositifs à l’image de la Convention Citoyenne pour le Climat).
Causes du présidentialisme
Ces réformes échouent cependant, parce qu’elles ignorent que la concentration des pouvoirs n’est qu’indirectement liée à la Constitution. Le président ne tient pas son pouvoir des compétences que lui donne le texte constitutionnel, ni même de « l’onction » du suffrage universel, mais principalement de sa relation à la majorité parlementaire, dont il est le chef véritable (sauf en période de cohabitation). La domination qu’il exerce sur la majorité n’est pas non plus la conséquence de l’élection au suffrage universel (de Gaulle l’exerçait de la même façon avant la révision de 1962), ni même de l’organisation du calendrier, qui désormais fait suivre l’élection présidentielle de l’élection législative, puisque le droit de dissolution permettait à un président nouvellement élu de provoquer aussitôt les élections, comme le fit Mitterrand en 1981 et en 1988.
Ce qui permet au président de dominer la majorité, c’est que c’est lui qui la constitue. Si l’élection au suffrage universel ne lui donne pas à elle seule des compétences juridiques, elle a fait de lui un chef de parti : c’est lui qui désigne les candidats à la députation et fait de son programme présidentiel leur programme. De la sorte, ses députés une fois élus, lui devant leur siège et eux voulant mériter une nouvelle investiture à la fin de la législature, ne peuvent que le soutenir.
D’ailleurs, dans d’autres pays, bien que le président de la République soit élu au suffrage universel comme en France, c’est un Premier ministre émanant d’une majorité parlementaire qui exerce le pouvoir. C’est le cas au Portugal [1], en Autriche, en Finlande ou encore en Irlande. Comment est-il possible que, sur la base de textes semblables, les systèmes politiques fonctionnent aussi différemment ? L’explication est simple. Au Portugal par exemple, les candidats à l’élection présidentielle sont sans doute des hommes et femmes politiques, mais ils se sont éloignés des partis, y compris de leurs partis d’origine, et ils se présentent sans programme de gouvernement. Le président élu désignera le Premier ministre, mais ce sera celui que lui indiquera la composition de l’Assemblée.
Le présidentialisme n’est donc pas imposé par la Constitution elle-même. Mais il est vrai que cette dernière y incite fortement parce qu’elle donne à penser que, quel que soit le projet politique auquel on aspire, le seul moyen de le réaliser est de se faire élire président, ce qui transforme tout le reste de la vie politique en moyens pour y parvenir. C’est vrai à droite, bien sûr, mais aussi à gauche : les socialistes ne font plus semblant de penser à autre chose depuis des lustres. Chez les écologistes, céder à cette obsession est devenu un standard de maturité (ceux qui continuent à ne pas vouloir que la politique se réduise à une élection sont invités à « grandir »). Pour les communistes, présenter un candidat à la présidentielle serait l’acte ultime d’une nécessaire affirmation identitaire. Et toute la stratégie de La France insoumise (LFI) passe nécessairement par la case élyséenne. Tous, mais chacun à sa manière, peuvent bien dire ce qu’ils veulent à propos de la démocratisation des pouvoirs et la transformation des institutions, ils jouent le jeu du présidentialisme avec la dernière énergie. On voit pourquoi : puisque seule compte vraiment l’élection présidentielle, jouer le jeu du présidentialisme serait le seul moyen d’exister. Sauf que pour la gauche, c’est aussi le plus sûr moyen de se perdre.
La gauche et les institutions
La gauche est idéologiquement très diverse, c’est sa richesse et sa force. Elle est traversée de courants étatistes et anarchistes, centralistes et girondins, libéraux et interventionnistes etc. En matière d’institutions, et en simplifiant, la tension oppose une gauche démocratique (au sens de la démocratie radicale) et une gauche plus républicaine (au sens de la république sociale).
La gauche démocratique est critique de toute captation oligarchique des pouvoirs politiques et économiques ; elle tire son origine des traditions anarcho-syndicaliste, conseilliste ou mouvementiste. Elle se garde de tout dispositif de représentation politique, au motif que ceux-ci opèrent des transferts souvent indus de prérogatives politiques. Elle est particulièrement critique de la plus mystique de ces formes, « l’incarnation » qui identifie le collectif à son chef. Mais elle se méfie aussi de la forme mandataire, qui préside à l’élection de nos députés, comme de la « gestion d’affaire », permettant de déléguer les affaires publiques à des bureaucrates non élus. Elle préfère la société à l’État, le tirage au sort aux élections, les AG aux organisations et aux hiérarchies. En un mot, elle rêve de la diffusion et du partage des pouvoirs pour le plus grand nombre.
En face, ou plutôt à côté, la gauche républicaine n’hésite pas à identifier le peuple au corps électoral plutôt qu’aux manifestants, et n’a rien contre l’État s’il est populaire. Elle puise ses inspirations dans la tradition antimonarchique, mais se méfie de la critique du parlementarisme, qu’elle associe au fascisme. Cette gauche-là non plus ne veut pas être la dupe de la représentation qu’elle estime n’être qu’une fiction utile. Elle préfère donc vivement le mandat parlementaire à l’incarnation présidentielle, jugé moins mystique (entendre : moins monarchiste catholique), et surtout susceptible de contrôles divers, par lesquels les représentants doivent rendre des comptes à leurs électeurs. Pour elle, la bureaucratie est un mal nécessaire, qui doit être placé sous l’étroit contrôle du Parlement.
Malgré ces considérables divergences idéologiques, des compromis pratiques, qui offrent un socle commun aux diverses propositions de la gauche en la matière, ont toujours été possibles : revalorisation du Parlement, présidence faible, scrutin proportionnel, renforcement des mécanismes de contrôle des élus et de l’initiative populaire, législative ou constitutionnelle, par voie référendaire, droit de pétition etc. La gauche démocratique y voit une manière de substituer des procédures participatives aux institutions représentatives, la gauche républicaine une manière de revitaliser ces dernières, mais les deux, ayant lu Brecht, se félicitent de l’effet de distanciation obtenu. Chacun voit donc les choses à sa manière, mais c’est assez pour se rassembler.
Surtout, c’est assez pour distinguer très clairement la gauche des forces qui rejettent en bloc toute forme d’institutionnalisation de la vie politique, et qui se manifestent ces temps-ci dans les velléités de candidatures de bouffons. C’est en effet une chose que de considérer que la représentation est une fiction parfois utile et parfois pas, c’en est une autre que de nier la nécessité de se doter de règles stables pour organiser la vie collective. Ce socle distingue aussi la gauche de certaines forces sociales-libérales qui, ayant entièrement abdiqué toute critique du présidentialisme, ne sont plus de gauche.
Le dilemme et le piège
Un tel contexte rend évidemment l’injonction présidentialiste de « se rassembler derrière un chef » beaucoup plus difficile à accepter pour la gauche que pour la droite. La difficulté à faire l’unité autour d’une candidature commune ne tient pas, comme on l’entend souvent, aux égos (pas plus pétulants à gauche qu’à droite), ou aux querelles de chapelles. À gauche comme à droite, la politique est aussi question de personnes et de partis, et c’est bien normal : LFI juge qu’un candidat socialiste trahirait les milieux populaires, les socialistes qu’un candidat radical serait incapable de l’emporter, les écologistes se méfient de l’étatisme de LFI… tous ont raison de leur point de vue. Mais tous ont aussi beaucoup à perdre lorsqu’il faut s’unir derrière un allié dont on se méfie.
Les partis de gauche doivent donc choisir entre perdre leur spécificité en s’unissant derrière un concurrent ou s’affaiblir en renforçant la division. Et ceux des partis qui le peuvent rêvent de sortir du dilemme en étant celui derrière qui on s’unit. La gauche est certes parvenue à l’unité en 1981, derrière Mitterrand, mais nombreux sont ceux qui pensent que l’expérience a bien plus changé la gauche que les institutions, et qu’elle marque le début de son déclin, parce que l’unité s’est faite au prix du sacrifice de sa diversité, qui est aussi sa richesse.
Il est vrai que, depuis, LFI propose une « formule » assez nouvelle, celle du « populisme de gauche », selon laquelle le chef est censé être une sorte de « médiateur évanouissant », destiné à cristalliser les forces pour les conduire à la victoire et ensuite à disparaître dans l’initiation d’un nouveau « moment constituant », conduisant à l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont la pierre angulaire est de dépouiller le président de ses pouvoirs. La formule est intéressante et audacieuse, mais elle se heurte à la structure du système (qu’elle ignore superbement). Mais on voit mal comment le « chef de gauche » devenu président ne serait pas immédiatement assiégé par de nombreuses et puissantes forces conservatrices, ni comment, dans ce contexte, il pourrait vouloir sacrifier les rares leviers dont il dispose, à commencer par ses prérogatives. On imagine en revanche fort bien comment il se résoudrait en tout bonne foi à jouer de tous les pouvoirs que lui confère la pratique présidentialiste des institutions. Il ne tarderait donc pas à devenir, plutôt que le « médiateur évanouissant » d’un nouveau processus constituant, un président comme les autres, un monarque élu. Comme à chaque fois qu’un « chef de gauche » a gagné. Non seulement la gauche ne peut s’unir derrière un chef qu’en s’affaiblissant, mais en gagnant, elle se renie, parce que sa victoire signe le renoncement à mettre en œuvre ses projets institutionnels.
La gauche est donc placée devant un dilemme : accepter d’être une « gauche de gouvernement » en faisant le contraire de ce qu’elle dit, ou rester de gauche en se contentant d’exercer une « fonction tribunicienne » qui acte son impuissance à changer la société. Depuis 1983, ce dilemme s’est transformé en un piège dont la gauche ne pourra se sortir sans changer préalablement le système. Il est grand temps d’en prendre acte.
Une proposition pour sortir du piège
Il faut commencer par se rappeler que le système conditionne les comportements et les représentations sans les déterminer entièrement. On peut donc chercher à le subvertir de l’intérieur. La stratégie consiste alors à jouer avec les marges de manœuvre pour en créer de nouvelles plus larges et ainsi de suite. Concrètement, si le régime est présidentialiste, c’est parce que le président nouvellement élu est aussi le chef de la majorité parlementaire. Mais cette confusion n’est elle-même rendue possible que parce que l’ensemble des acteurs, y compris de gauche, ont l’esprit tellement colonisé par les pratiques présidentialistes qu’ils sont devenus incapables de s’imaginer changer le pays autrement qu’en gagnant la présidentielle. Ne pas céder à ce renoncement, qui commande tous les autres, consiste à penser contre le présidentialisme de l’intérieur même de la Ve République.
Une proposition
Plusieurs idées sont possibles. On pourrait par exemple imaginer que la gauche refuse de présenter un candidat à la présidentielle pour se concentrer sur les législatives. Cette solution aurait le mérite d’ouvrir une campagne politique contre le présidentialisme et de redonner de la cohérence aux partis de gauche. Elle aurait le désavantage dirimant de laisser un boulevard à la droite et à l’extrême droite.
Dans une tribune publiée par Libération, nous avons proposé que les forces de gauche s’accordent pour embaucher un acteur, ou une actrice, pour se présenter en leur nom. Rien à voir avec la candidature plus ou moins spontanée d’un bouffon anti-establishment, puisque cet acteur·trice est présenté·e par les partis de gauche et s’engage à faire campagne sur les éléments que chacun de leurs programmes ont en commun. Cette campagne devra d’ailleurs être entièrement dirigée par un comité unitaire créé à cette fin. Ce comité aura pour tâche d’élaborer non pas un véritable programme de gouvernement, mais tout au plus une plate-forme électorale commune, assortie de diverses options. C’est assez pour mener campagne de manière crédible et de nombreuses initiatives récentes montrent que la convergence nécessaire à sa conception n’est pas hors de portée (même sur des sujets aussi difficiles que la croissance ou l’Europe [2]). Chaque parti pourra faire campagne sur ses thèmes de prédilection. Certains choix d’options et arbitrages peuvent être laissés en suspens, dans l’attente que le rapport entre les forces de gauche soit scellé par les législatives. Et c’est alors seulement qu’on pourra s’accorder sur le choix du Premier ministre, l’attribution des ministères et le programme définitif du gouvernement.
Bien sûr, tout ceci suppose non seulement que la gauche gagne les élections législatives mais aussi qu’elle parvienne à former une coalition gouvernementale. C’est le but de notre proposition. Si la droite devait gagner, ce serait à elle de former une coalition ; notre proposition aurait échoué à faire revenir la gauche au pouvoir, mais aurait tout de même le mérite de nous avoir sortis du présidentialisme. Et si la gauche devait gagner sans réussir à s’unir, notre proposition aurait aussi échoué, mais il serait toujours possible d’élargir le spectre de la coalition pour trouver une majorité de gouvernement.
Cette proposition nous paraît idéologiquement, politiquement et juridiquement intéressante.
Idéologiquement, une telle candidature redonnera des couleurs à la gauche, en replaçant la question de la représentation, et de sa fétichisation, au centre du débat politique. L’acteur·trice dira les discours qu’on lui écrira, défendra la plate-forme électorale des partis qui la soutiennent, mais surtout, rappellera une vérité importante : il ou elle n’est qu’un·e acteur·trice, qui n’incarne ni une majorité parlementaire ni le peuple. Élu·e, il ou elle sera mandaté·e par lui, mais ce mandat ne le ou la confondra pas avec ses mandataires. Sa simple existence rappellera que le représentant n’est pas le représenté, ou pour le dire avec Magritte, que « ceci n’est pas une pipe ». Du point de vue de la gauche démocratique, il s’agira de renouer avec une tradition de subversion des institutions, comme quand le Parti communiste (PC) présentait en 1925 aux élections municipales des femmes, non éligibles à l’époque, pour exiger que celles-ci le deviennent.
Du point de vue de la gauche républicaine, il s’agira de revenir à ses sources antimonarchiques, comme lorsque Condorcet, à qui l’on objectait la nécessité de préserver la monarchie, proposait alors de remplacer le Roi par un automate [3]. Cette solution dit en effet, mieux que tout discours, ce que nos concitoyens expriment déjà fort bien par l’abstention ou autour des ronds-points, que la France n’a pas besoin d’un « chef », encore moins d’un « père », et peut-être pas même d’un président ; que la démocratie n’est pas non plus tout à fait soluble dans la représentation, qui n’est qu’une fiction parfois utile, mais pas toujours ; que la politique est aussi une mise en scène, un jeu sérieux auquel on peut jouer sérieusement sans croire aux fictions qui le fondent, en y jouant même d’autant mieux qu’on n’y croit pas.
Politiquement, notre proposition a le mérite de faciliter le rassemblement de la gauche autour d’une candidature unique, sans sacrifier sa diversité, puisque chacun de ses leaders fera campagne sur son propre programme, dans le cadre de la plate-forme électorale commune. Ils feront ainsi vivre le pluralisme de la gauche, sans sacrifier à l’unité nécessaire pour conquérir des majorités d’idées et des rapports de force. De fait, la campagne des présidentielles serait surtout le prologue de la mère des batailles, les législatives.
Elle permet en outre de sortir d’un autre vice du présidentialisme, la personnalisation de la vie politique. Sans doute, journalistes et opposants attaqueront notre acteur·trice sur son engagement. Il est pourtant limpide : il ou elle est là pour faire son métier, réciter son script. Sa vie privée, son opinion personnelle ne touchent pas à la question : il ou elle se contente de mettre en scène, le mieux possible, la plate-forme électorale de la gauche. Il ou elle peut donc même faire la une de Paris-Match si on le lui propose : cela n’apprendra rien aux électeurs des idées qu’il ou elle joue à défendre.
Une telle candidature offre encore une alternative crédible à celle des clowns, qu’il s’agisse de ceux dans la lignée de Berlusconi et Trump ou dans celle de Coluche et Bigard. L’acteur·trice partage certes avec eux certains talents, et éventuellement la notoriété. Mais sa candidature signifie le contraire de l’effondrement du politique dans l’avènement de la souveraineté grotesque telle que décrite par Foucault [4]. Elle ne vise pas à destituer les institutions en les moquant, mais au contraire, et très explicitement, à mettre leurs rouages en lumière en les faisant jouer au service d’un projet de transformation du régime. Il s’agit bien de mettre en scène une fiction, mais cette fiction est éminemment politique et elle n’est pas une farce.
Cette proposition a encore le mérite de se situer assez précisément au point d’intersection des gauches démocratique et républicaine pour espérer qu’elle soit non seulement acceptable, mais hautement désirable pour l’une comme pour l’autre, à la condition bien sûr que l’une et l’autre veuillent bien se souvenir qu’elles sont radicalement opposées au présidentialisme.
Juridiquement, cette proposition est robuste. Il faut certes éviter de signer un contrat en bonne et due forme, ce qui suppose de trouver un acteur ou une actrice qui accepte ce rôle par conviction. Ce qui compte surtout, c’est qu’il ou elle ait le soutien des partis, donc du comité unitaire. Ce soutien rendrait facile la collecte des signatures, comme le financement de la campagne électorale.
Mais que se passera-t-il si l’acteur·trice gagne ? Ne disposera-t-il ou elle pas de pouvoir immenses ? Il faut rappeler avant tout que les pouvoirs d’une autorité quelconque procèdent de la Constitution, et que ceux que la Constitution de 1958 confère au président sont limités. Certes, de Gaulle a joué avec l’idée que le président « procède » du peuple et le Premier ministre du président, comme l’Esprit procède du Père et du Fils pour ne faire qu’un avec lui, mais une relation mystique ne confère par elle-même aucun pouvoir.
Les pouvoirs du président sont limités avant tout par le principe que les actes du président doivent-être contresignés par le Premier ministre, ce qui signifie que le Premier ministre, en refusant, peut entraîner la nullité de ces actes. C’est ce qui explique le développement du régime parlementaire, et aussi pourquoi, en période de cohabitation, le président doit céder l’essentiel de son pouvoir au Premier ministre.
Il est vrai que certains actes sont dispensés du contreseing, mais comme nombre de ces derniers présupposent la participation décisionnelle d’une autre autorité [5], le risque de voir notre acteur·trice user de ces actes pour se lancer dans une aventure personnelle est limité.
De fait, le président n’exerce seul que deux pouvoirs très importants : le droit de dissolution et le fameux article 16. Il en va cependant du droit de dissolution comme de beaucoup d’autres : il ne suffit pas d’en disposer pour être en mesure de s’en servir. Or, le président n’a aucun intérêt à dissoudre s’il n’a pas la possibilité de disposer d’une majorité à l’issue des élections qui suivront. À chaque fois que le président a prononcé la dissolution, c’était parce qu’il avait un espoir de disposer d’une majorité cohérente et disciplinée. Et quand il a mal mesuré ses chances, comme Mac Mahon ou Chirac, l’on a vu ce qu’il lui en a coûté. Notre acteur·trice élu·e, quand bien même il lui prendrait la fantaisie de vouloir réellement exercer le pouvoir politique, aurait les plus grandes difficultés à prendre la tête d’un mouvement à vocation majoritaire, n’ayant aucune autonomie politique propre. Quant à l’article 16, il n’est pas d’un maniement facile, même pour un apprenti dictateur, s’il ne dispose pas de réseaux dans l’administration et dans l’armée. Même Trump, quand il est allé trop loin, s’est heurté au refus d’obéissance de ceux qui jusque-là, semblaient lui être dévoués.
Bref, si les aventures personnelles sont toujours possibles, notre proposition a le mérite de les rendre beaucoup plus difficiles que ne le fait la configuration actuelle. Il y a donc fort à parier que si l’acteur·trice gagne, il ou elle se trouvera dans la même situation que le président du Portugal [1]. Il ou elle n’aura pas présenté de programme de gouvernement, n’aura pas été à la tête d’un parti ni même d’une coalition et n’aura pesé en rien sur les élections législatives, qui verront s’affronter des partis. Les élections législatives se dérouleront selon le mode de scrutin actuel. La gauche, forte de sa victoire, aura de bonnes chances de les gagner, et même si aucun de ses chefs ne peut gagner une élection présidentielle, chacun d’eux pourra peser lourd dans une coalition parlementaire. Cette dernière choisira un Premier ministre qui gouvernera le pays, attribuera les ministères et s’accordera sur un programme définitif de gouvernement.
Objections à notre proposition
Après la publication de notre tribune, nous avons reçu de nombreuses remarques et objections. Répondre à quelques-unes permet de préciser le sens de notre démarche.
La première, et la principale, est évidemment que cette proposition « n’est pas réaliste ». Il est vrai que cette proposition paraît utopique. Ce n’est déjà pas si mal. En effet, une « proposition utopique » n’est pas seulement une proposition concrètement irréalisable, c’est aussi une proposition destinée à dévoiler un impensé idéologique. En l’espèce, nombreux sont ceux qui, même à gauche, trouvent que toute proposition sortant trop du jeu ordinaire du présidentialisme n’est « pas réaliste ». Ils devraient commencer par se demander de quoi leur réticence est le symptôme. Surtout, notre proposition n’est pas seulement utopique. Elle est réaliste parce qu’elle est concrètement réalisable sur le plan institutionnel. Et « concrètement réalisable » ne veut pas seulement dire qu’il suffirait qu’on l’adopte pour la réaliser, mais qu’il est dans l’intérêt de tous les dirigeants des partis de gauche de l’adopter.
Ceux de ces dirigeants qui ne peuvent pas espérer gagner la présidentielle y ont intérêt, parce qu’elle évite que leur poids dans la coalition finisse dilué dans la « majorité présidentielle » godillot après leur échec aux élections. Ainsi, Monsieur Roussel (secrétaire national du PCF ) trouvera aux législatives l’occasion d’affirmer l’existence de son parti, sans risquer une déroute à la présidentielle. De même, s’il fut un temps où les écologistes pouvaient vouloir miser sur une élection nationale du fait de leur faible implantation locale, ils n’ont désormais plus à craindre que l’élection législative soit l’épreuve décisive.
Ceux des dirigeants qui peuvent espérer gagner la présidentielle y ont aussi intérêt, parce que la proposition permet d’éviter que leur candidature fasse courir un risque mortel à toute la gauche, et parce que la victoire de l’acteur·trice leur permet d’espérer raisonnablement prendre la tête de la majorité parlementaire de gauche en gagnant les législatives. Leur leader deviendra alors Premier ministre et gouvernera le pays sans être entravé par le président, désormais dépourvu de pouvoirs réels. Certes, Madame Hidalgo, Monsieur Mélenchon ou Monsieur Jadot devront renoncer à prétendre « incarner la France », mais en démocratie, on peut gouverner sans prétendre incarner quoi que ce soit.
Enfin, tous les dirigeants des partis de gauche y auraient intérêt, parce qu’au lieu de se faire concurrence et de brouiller leur message en s’affaiblissant mutuellement, en mettant leurs forces au service de la victoire de l’acteur·trice, ils placeront donc leur parti en position de peser d’un poids réel dans le futur gouvernement, qui sera proportionnel à leur force, mais augmenté par la dynamique unitaire. Tous peuvent au moins prétendre à un grand ministère. On s’accordera que c’est mieux que de perdre dans la division.
Notre proposition est donc réaliste. Elle le serait du moins, si les leaders de la gauche étaient capables de se décoloniser l’esprit et d’agir conformément à leurs intérêts. Mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas. Non pas parce que ce sont de mauvais dirigeants aveuglés par leur égo et leur chapelle, mais parce que la politique n’est pas tant affaire de calculs rationnels que de passions, d’habitudes et de préjugés. Et c’est vrai que, si notre proposition supposait que les dirigeants de la gauche puissent faire abstraction de leurs passions, habitudes et préjugés, elle serait tout à fait irréaliste, parce que cela n’arrivera jamais.
Ce qui arrivera vraisemblablement, c’est que les dirigeants de la gauche se présenteront à l’élection présidentielle en ordre dispersé, dans l’espoir qu’en « tuant le match », ils imposent aux autres candidats de se rallier à eux, jusqu’à rassembler assez de voix pour être présents au second tour. Mais on sait déjà que jouer à « tuer le match » est une stratégie hasardeuse, dont la gauche elle-même risque de ne pas sortir vivante.
Mais c’est à ce moment précis que notre proposition pourrait redevenir tout à fait « réaliste ». Imaginons que quelque part dans les mois à venir, tous les candidats déclarés constatent qu’ils plafonnent autour de 10 % et que la division a tellement démobilisé les électeurs que la somme de leurs voix est ridicule. Imaginons donc qu’ils se rendent compte qu’ils n’ont pas tué le match, mais que le match les a tués. Peut-être seront-ils alors aveuglés par l’espoir d’un redressement ultime et héroïque, et persévèreront-ils jusqu’au bout dans leur stratégie. Mais peut-être se rendront-ils compte qu’ils sont en train de se suicider politiquement, en sacrifiant durablement la gauche. Peut-être surtout sentiront-ils la pression d’un électorat mobilisé en faveur de l’union. Et peut-être se demanderont-ils alors comment sortir du piège où ils se sont placés eux-mêmes. Peut-être alors se réuniront-ils pour discuter désistements, programme et répartition des places. Ils achopperont alors nécessairement sur la répartition de la seule place qui compte, celle de président. Et là, notre proposition est à leur disposition pour dénouer la situation, en choisissant d’échanger la chronique d’une défaite présidentielle annoncée contre une chance de succès parlementaire. C’est réaliste.
Deuxième objection : « Vous ne vous rendez pas compte, pour se présenter à la présidentielle, il faut être un guerrier de l’espace ». N’ayant jamais vécu de présidentielle de l’intérieur, ceci est vrai : nous ne nous rendons pas compte. Et nous sommes prêts à entendre que le degré de fatigue et de pression, la perversité des coups fourrés, le poids des responsabilités sont tels que non seulement cette élection rend fou, mais qu’elle exige de ceux qui osent s’y lancer qu’ils soient préalablement très névrosés. Ne s’improvise pas leader charismatique qui veut. Il faut savoir déjouer les coups fourrés, fourrer les coups, vivre légèrement les plus lourdes responsabilités, endurer avec entrain la fatigue et la pression, prendre les bonnes décisions, séduire et convaincre. Être un guerrier de l’espace.
L’acteur·trice endurerait fatigue et pression, devrait séduire et convaincre mais n’aurait ni à fourrer les coups, ni à porter les responsabilités, ni même à décider, puisque les chefs aguerris du comité unitaire de campagne s’en chargeraient. Notre proposition n’ôte donc rien à la violence ordinaire de la vie politique, mais cette violence sera endurée non pas tant par l’actrice que par les dirigeants des partis de gauche qui la soutiennent. Voter pour lui ou elle, c’est en effet voter pour eux. Ce qui réduirait d’autant l’intérêt des adversaires de s’attaquer directement à lui ou à elle.
Objection numéro trois : « L’acteur·trice vous trahira parce que le pouvoir corrompt ». En politique, la trahison est toujours possible. Les exemples historiques de corruption par le pouvoir sont légion et personne ne peut savoir ce que le thrill de la victoire est capable de produire dans la psyché de l’acteur·trice. Mais pour vouloir exercer du pouvoir, il faut commencer par en avoir un peu, ou du moins espérer en avoir. Ce ne sera pas le cas : l’acteur·trice n’aura aucune chance de pouvoir contrôler les parlementaires de gauche, qui doivent leur poste à leur parti et non pas à lui ou elle. Il ou elle n’aura aucun moyen de pression sur le Premier ministre. En revanche, la majorité parlementaire de gauche pourrait réduire drastiquement le budget de l’Élysée, une éventualité que notre acteur·trice devra ne pas oublier quand il ou elle se sentira pousser des ailes.
Quatrième objection: « Votre proposition est sexiste ». Il faut l’admettre. Mais nous sommes pris dans une contradiction, qui n’est pas seulement la nôtre. Si nous proposons que notre acteur·trice soit un acteur, nous reconduisons servilement le virilisme avilissant qui domine nos représentations ordinaires : pour être sérieusement un « guerrier de l’espace », il faudrait être un homme. L’élection présidentielle ne serait gagnable que dans un grand déploiement de testostérone, les Français ne peuvent accorder leur confiance qu’à une figure paternelle, etc. Mais si nous proposons que notre acteur soit une actrice, comment éviter le reproche que c’est précisément au moment où il s’agit de transformer le président en potiche impotente qu’on pense aussi à féminiser la fonction ? Il n’y a aucun moyen d’échapper à cette contradiction, qui nous ennuie puissamment. Pour notre part, nous serions enclins à préférer que ce soit une femme, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de voir la gauche nous doter d’une présidente pour la première fois dans l’histoire du pays. Mais comment nier que cette solution verse dans le stéréotype de la plante verte ? En tout état de cause, le comité unitaire de campagne aura là une décision difficile à prendre.
Cinquième et dernière objection : « Vous voulez restaurer le parlementarisme, le retour à la IVe république ». Il y a au moins deux manières de répondre à cette objection : la première, que la gauche républicaine ne désavouera pas, consiste à défendre la IVe république. La seconde, qui devrait avoir la préférence de la gauche démocratique, s’attache à souligner que l’élection de l’acteur·trice est susceptible d’ouvrir une phase de créativité politique nouvelle, et pas seulement de restaurer le parlementarisme.
Cette objection correspond à une conception très répandue chez les juristes, selon laquelle l’histoire constitutionnelle française obéirait à des lois. L’évolution aurait d’abord été cyclique : entre 1789 et 1815, la France serait passée de la monarchie constitutionnelle à la République puis à l’Empire, et cette succession se serait répétée entre 1815 et 1852. Elle serait devenue linéaire à partir de 1870 : chaque régime marque un progrès par rapport au précédent, la IVe cherchant vainement à corriger les défauts de la IIIe. C’est seulement avec la Ve que la France connaîtrait enfin un système stable, efficace et conforme aux idéaux de l’État de droit et de la démocratie. Difficile de ne pas voir dans ce récit une justification ad hoc des institutions présentes plutôt qu’une interprétation crédible de l’histoire.
Mais que reproche-t-on au juste à la IVe République ? Si l’on met à son crédit la reconstruction, l’expansion économique et la protection sociale, on lui impute l’échec de la décolonisation (mais c’est certainement trop attribuer aux institutions politiques de la métropole dans l’affaire). Quant aux vices de ces institutions elles-mêmes, on souligne l’instabilité ministérielle, l’omnipotence du Parlement et sa propension à abandonner au gouvernement une grande partie de son pouvoir, faute de pouvoir l’exercer. Sur ce dernier point, il faut rappeler que c’est là un trait commun à tous les parlements du monde et qu’on le retrouve encore plus accentué sous la Ve République. Quant à l’instabilité ministérielle, elle est incontestable, mais elle était due moins au dispositif constitutionnel qu’à la présence à l’Assemblée nationale de groupes importants, le RPF et le PC, qui n’entraient dans aucune coalition, avec pour conséquence qu’un gouvernement ne pouvait se former et se maintenir qu’avec le soutien de presque tous les autres. Si l’instabilité a disparu après 1958, ce n’est pas tant par le miracle de l’article 49.3 ou par la menace de la dissolution que grâce à la présence quasi constante d’une majorité. Mais c’est au prix de l’abaissement du Parlement et de cette majorité elle-même.
Au final, l’expérience de la IVe République a fait croire, à tort, que le parlementarisme conduisait inéluctablement à l’instabilité. Il y a pourtant bien des États, de l’Allemagne au Portugal, dans lesquels les parlements parviennent à dégager des majorités et même des majorités de coalition qui permettent de gouverner de façon équilibrée.
Si la restauration du parlementarisme ne signe pas forcément le retour de l’instabilité ministérielle, il faut noter qu’elle ne suffit pas non plus à garantir contre la concentration et la personnalisation du pouvoir (voir Netanyahu en Israël), encore qu’elle contribue à compliquer singulièrement l’accaparement monarchique des pouvoirs. Mais il faut surtout noter que cette restauration est un socle à partir duquel le régime peut évoluer dans plusieurs directions, y compris celle de la réalisation des projets les plus audacieux de la gauche.
Aujourd’hui, ces projets se disent surtout dans les termes d’une « VIe République » qui se substituerait à la Constitution de la Ve. Et si l’on peut changer de régime sans changer le texte constitutionnel, on peut aussi vouloir changer le texte pour aller plus loin dans le partage et le contrôle des pouvoirs. La victoire de l’acteur·trice serait donc synonyme de restauration du parlementarisme sans changer la constitution, mais serait aussi susceptible d’ouvrir une phase nouvelle de créativité politique. Tous les projets actuels de VIe République ont en effet pour socle un régime parlementaire monocaméral, auquel sont associés des dispositions de contrôle strict des élus (renouvellement et contrôle régulier des mandats, recall etc.) et de démocratie participative (initiative législative et référendaire populaire, droit de pétition, conventions citoyennes tirées au sort). Parce que tous ces projets visent aussi à neutraliser le pouvoir politique du président, aucun n’est crédible s’il doit être porté par un président fort pour être réalisé. Il peut en revanche être porté par le Premier ministre et sa majorité parlementaire, si le président est notre acteur·trice.
Rien n’interdit en effet à la majorité de gauche au Parlement de vouloir modifier la Constitution. Suite à l’élection de l’acteur·trice, les forces de gauche majoritaires au Parlement doivent pour ce faire obtenir le vote d’un projet de révision dans chaque chambre, puis les trois cinquièmes du Congrès ou bien l’adoption par référendum. Une voie difficile, étant donné la composition du Sénat. Une autre option serait, plutôt que de réviser la Constitution, de convoquer une Assemblée constituante ; il faudrait cependant au préalable réviser la procédure de révision, avec les mêmes difficultés. Une troisième solution consisterait à soumettre le projet directement au référendum (article 11 de la Constitution), sans passer par le Parlement, comme de Gaulle l’a fait en 1962. L’initiative appartiendrait à l’acteur·trice (sur proposition du Premier ministre) ou à défaut à l’initiative de la majorité de chacune des deux chambres. La constitutionnalité de cette démarche est certes très incertaine, et le Conseil constitutionnel pourrait vouloir la bloquer (encore que sa compétence en la matière soit elle aussi très incertaine [6] et qu’il n’ait pas jugé bon d’en faire usage en 1962 et en 1969). S’il devait s’opposer à son adoption, il ouvrirait un conflit politique dont l’issue est indécise.
Ce qui est certain, c’est qu’un tel changement de la Constitution ne pourrait reposer que sur un mouvement populaire puissant, difficile à imaginer quand on regarde le paysage politique actuel. Il est aussi certain que, pour s’engager dans une telle bataille sans craindre de la voir déboucher sur un épisode césariste, il est très préférable que le président soit préalablement dépouillé de l’essentiel de sa capacité politique d’agir. Non seulement notre proposition n’interdit pas les audaces de la gauche démocratique, mais en les délestant du risque autoritaire qu’elles portent, elle répond aux craintes que la gauche républicaine nourrit à leur endroit. Autrement dit, là encore, notre proposition est susceptible de se situer au point d’intersection des deux traditions constitutives de la gauche : celle qui n’a rien contre la IVe et celle qui préfèrerait en inventer une VIe.
Quant à la droite, il est bien difficile de prévoir sa réaction à une victoire de l’acteur·trice. Certains se féliciteront d’un possible retour au parlementarisme. Après tout, il n’y a pas qu’à gauche qu’on pense que l’hyper-concentration du pouvoir conduit à l’impotence et que la vie politique mérite mieux qu’une course de chevaux. D’autres, sans aucun doute, souhaiteront le retour du présidentialisme. Certains se féliciteront d’un changement de constitution favorable au Parlement, à la proportionnelle et aux initiatives populaires, d’autres y verront une catastrophe. L’essentiel ici est précisément que chacun des scénarios rendus possibles par l’adoption de notre proposition sont aussi susceptibles de trouver de forts soutiens à droite. Et qu’en tout état de cause, les institutions fonctionneront.
On l’aura compris, notre proposition est modeste. Elle vise seulement à porter un coup d’arrêt à la pratique présidentialiste, sans avoir au préalable à changer de constitution. Si elle devait fonctionner, nous serions toujours sous la Ve République, mais dans sa version parlementaire. Elle serait en outre susceptible d’ouvrir un nouveau chapitre de notre vie politique. Nous ne prétendons certes pas transformer le système politique par un simple artifice politico-juridique. Mais nous prétendons que cet artifice, ou un autre qui serait meilleur, permettrait à la gauche de sortir du piège mortel dans lequel elle se trouve, permettrait aux institutions existantes de mieux fonctionner et offrirait une possibilité intéressante à ceux qui veulent les changer. Et puis quelle est l’alternative : la défaite ou la fausse victoire sur un coup de chance ? Qu’a-t-on à perdre à essayer ? Pas grand-chose, on est déjà presque mort.
[1] Au Portugal, dont la constitution a été inspirée par la Constitution française, le président de la République y est élu comme en France, au suffrage universel à deux tours, également pour cinq ans. Il a même des pouvoirs plus importants que le président français, par exemple un droit de veto législatif, qui, pour les textes les plus importants, ne peut être surmonté qu’à la majorité des deux tiers, ou le droit de révoquer le Premier ministre dans certaines conditions. Et pourtant, ce président n’exerce qu’une magistrature d’influence, comparable à celle du président de la République italienne ou du président de la IVe République française.
[2] Pour une mise au point récente : Abel Mestre et Sylvia Zappi, « Union de la gauche, la partie d’échecs continue », Le Monde, 10 février 2021. Voir aussi ces initiatives de la société civile : Nabil Wakim et Sylvia Zappi, « De la CGT à Greenpeace, une alliance inédite entre syndicats et mouvements écologistes », Le Monde, 26 mai 2020. Voir encore, autre autres, les initiatives pour une candidature commune à gauche : « 2022, (vraiment) en commun » : l’appel d’élus et activistes de gauche à « une alternative écologique, sociale et démocratique » au néolibéralisme pour la présidentielle sur France Info le 10 octobre 2020 ou encore l’appel à un « Big Bang de la gauche » dans Le Monde, Abel Mestre, 29 juin 2019.
[3] Condorcet, « Lettre d’un jeune mécanicien », Œuvres de Condorcet, tome 12, Didot, 1847, p. 251-253.
[4] Michel Foucault, « Cours du 8 janvier 1975 », in Les anormaux, Cours au collège de France 1974-1975, Paris, EHESS, Gallimard-Seuil, 1999. Pour une reprise de ces thèses au soutien d’une analyse de la présidence Trump, voir l’article de Christian Salmon, « L’hyperréaliste du bouffon — Trump et l’élection de 2020 », AOC, 5 novembre 2020.
[5] Le président de la République peut soumettre au référendum certains projets de loi (mais seulement sur proposition du Premier ministre ou des assemblées) ou un projet de révision constitutionnelle (mais uniquement après un vote par les deux assemblées en termes identiques). Il nomme seul le Premier ministre ou met fin à ses fonctions, mais il est de fait contraint de le choisir dans la majorité parlementaire. Il peut saisir le Conseil constitutionnel d’un traité international ou d’une loi qui vient d’être adoptée, mais ce sera la juridiction qui décidera de leur validité.
[6] Le Conseil constitutionnel se juge compétent pour contrôler le décret de convocation des électeurs, au fondement de l’article 60 de la Constitution qui lui confie « la charge de veiller au bon déroulement des opérations de référendum ». Mais la nature et la portée de ce contrôle restent très débattues pour ce qui concerne un référendum constituant – voir Jean-Marie Garrigou-Lagrange, « Les contrôles du Conseil constitutionnel sur les décrets de convocation des électeurs au référendum », Les Petites affiches, 2002, n° s.n., p. 4-12.
Juriste, Professeur émérite de droit public, Université Paris-Nanterre
Juriste, Professeur de droit public, École de droit de Sciences Po
Pour sauver la gauche, déprésidentialisons !
Par Michel Troper et Mikhail Xifaras
publicité
Ça y est, nous y sommes. Dans un éditorial récent, un journal du soir jugeait plausible la disparition de la gauche aux prochaines élections présidentielles. C’est une mauvaise nouvelle : sans la gauche, toute contestation du néolibéralisme technocratique dominant ne trouverait plus à se dire que dans les mots de l’extrême droite. Il y a beaucoup à faire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mais aussi, peut-être, pour ne pas en arriver là. Un élément central de l’analyse nous semble être le fonctionnement des institutions. À trop se concentrer sur les rapports de force et les débats d’idées qui font la vie politique, on oublie que cette dernière est structurée par des dispositifs juridiques aux effets puissants. Ce sont ces dispositifs qui se transforment en piège mortel pour la gauche.
Jouer le jeu du présidentialisme pour exister ?
Dans le temps long, l’histoire constitutionnelle est marquée par la concentration des pouvoirs dans les mains de l’exécutif. Il prend dans notre pays la forme d’une pratique présidentialiste des institutions. Les défauts d’une telle pratique sont bien connus : la concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président et corrélativement, la réduction de la vie politique à la préparation de l’élection présidentielle à venir ; l’inévitable tension entre le président de la République et le Premier ministre, tantôt « collaborateur », tantôt rival ; la préoccupation exclusive pour la personne des candidats potentiels au détriment de leurs idées et de leurs programmes, si toutefois ils en ont ; le déclin des partis politiques qui ne sont plus que des machines à sélectionner les candidats. Les législatives servent à valider le choix effectué à la présidentielle et les parlementaires, redevables de leur poste au président, sont des godillots. Tout l’intérêt et l’importance de la politique s’en trouvent laminés.
Outre la tentation d’en user arbitrairement ou autoritairement, la concentration des pouvoirs entraîne paradoxalement une très grande difficulté à les exercer. Le président omnipotent reçoit la tâche impossible de changer la vie de ses concitoyens, tout seul depuis son bureau. Et comme il est responsable de tout, toute crise devient une crise de légitimité. De plus, cette concentration incite en permanence ceux qui ne peuvent s’exprimer à travers les institutions à descendre dans la rue. Ces défauts sont si bien connus qu’on multiplie les réformes censées la limiter (telles l’introduction des Questions prioritaires de constitutionnalité et la limitation au recours de l’article 49.3 dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) ou la contrebalancer par la prise en considération de l’opinion (grâce, par exemple, au référendum d’initiative partagée ou à des dispositifs à l’image de la Convention Citoyenne pour le Climat).
Causes du présidentialisme
Ces réformes échouent cependant, parce qu’elles ignorent que la concentration des pouvoirs n’est qu’indirectement liée à la Constitution. Le président ne tient pas son pouvoir des compétences que lui donne le texte constitutionnel, ni même de « l’onction » du suffrage universel, mais principalement de sa relation à la majorité parlementaire, dont il est le chef véritable (sauf en période de cohabitation). La domination qu’il exerce sur la majorité n’est pas non plus la conséquence de l’élection au suffrage universel (de Gaulle l’exerçait de la même façon avant la révision de 1962), ni même de l’organisation du calendrier, qui désormais fait suivre l’élection présidentielle de l’élection législative, puisque le droit de dissolution permettait à un président nouvellement élu de provoquer aussitôt les élections, comme le fit Mitterrand en 1981 et en 1988.
Ce qui permet au président de dominer la majorité, c’est que c’est lui qui la constitue. Si l’élection au suffrage universel ne lui donne pas à elle seule des compétences juridiques, elle a fait de lui un chef de parti : c’est lui qui désigne les candidats à la députation et fait de son programme présidentiel leur programme. De la sorte, ses députés une fois élus, lui devant leur siège et eux voulant mériter une nouvelle investiture à la fin de la législature, ne peuvent que le soutenir.
D’ailleurs, dans d’autres pays, bien que le président de la République soit élu au suffrage universel comme en France, c’est un Premier ministre émanant d’une majorité parlementaire qui exerce le pouvoir. C’est le cas au Portugal [1], en Autriche, en Finlande ou encore en Irlande. Comment est-il possible que, sur la base de textes semblables, les systèmes politiques fonctionnent aussi différemment ? L’explication est simple. Au Portugal par exemple, les candidats à l’élection présidentielle sont sans doute des hommes et femmes politiques, mais ils se sont éloignés des partis, y compris de leurs partis d’origine, et ils se présentent sans programme de gouvernement. Le président élu désignera le Premier ministre, mais ce sera celui que lui indiquera la composition de l’Assemblée.
Le présidentialisme n’est donc pas imposé par la Constitution elle-même. Mais il est vrai que cette dernière y incite fortement parce qu’elle donne à penser que, quel que soit le projet politique auquel on aspire, le seul moyen de le réaliser est de se faire élire président, ce qui transforme tout le reste de la vie politique en moyens pour y parvenir. C’est vrai à droite, bien sûr, mais aussi à gauche : les socialistes ne font plus semblant de penser à autre chose depuis des lustres. Chez les écologistes, céder à cette obsession est devenu un standard de maturité (ceux qui continuent à ne pas vouloir que la politique se réduise à une élection sont invités à « grandir »). Pour les communistes, présenter un candidat à la présidentielle serait l’acte ultime d’une nécessaire affirmation identitaire. Et toute la stratégie de La France insoumise (LFI) passe nécessairement par la case élyséenne. Tous, mais chacun à sa manière, peuvent bien dire ce qu’ils veulent à propos de la démocratisation des pouvoirs et la transformation des institutions, ils jouent le jeu du présidentialisme avec la dernière énergie. On voit pourquoi : puisque seule compte vraiment l’élection présidentielle, jouer le jeu du présidentialisme serait le seul moyen d’exister. Sauf que pour la gauche, c’est aussi le plus sûr moyen de se perdre.
La gauche et les institutions
La gauche est idéologiquement très diverse, c’est sa richesse et sa force. Elle est traversée de courants étatistes et anarchistes, centralistes et girondins, libéraux et interventionnistes etc. En matière d’institutions, et en simplifiant, la tension oppose une gauche démocratique (au sens de la démocratie radicale) et une gauche plus républicaine (au sens de la république sociale).
La gauche démocratique est critique de toute captation oligarchique des pouvoirs politiques et économiques ; elle tire son origine des traditions anarcho-syndicaliste, conseilliste ou mouvementiste. Elle se garde de tout dispositif de représentation politique, au motif que ceux-ci opèrent des transferts souvent indus de prérogatives politiques. Elle est particulièrement critique de la plus mystique de ces formes, « l’incarnation » qui identifie le collectif à son chef. Mais elle se méfie aussi de la forme mandataire, qui préside à l’élection de nos députés, comme de la « gestion d’affaire », permettant de déléguer les affaires publiques à des bureaucrates non élus. Elle préfère la société à l’État, le tirage au sort aux élections, les AG aux organisations et aux hiérarchies. En un mot, elle rêve de la diffusion et du partage des pouvoirs pour le plus grand nombre.
En face, ou plutôt à côté, la gauche républicaine n’hésite pas à identifier le peuple au corps électoral plutôt qu’aux manifestants, et n’a rien contre l’État s’il est populaire. Elle puise ses inspirations dans la tradition antimonarchique, mais se méfie de la critique du parlementarisme, qu’elle associe au fascisme. Cette gauche-là non plus ne veut pas être la dupe de la représentation qu’elle estime n’être qu’une fiction utile. Elle préfère donc vivement le mandat parlementaire à l’incarnation présidentielle, jugé moins mystique (entendre : moins monarchiste catholique), et surtout susceptible de contrôles divers, par lesquels les représentants doivent rendre des comptes à leurs électeurs. Pour elle, la bureaucratie est un mal nécessaire, qui doit être placé sous l’étroit contrôle du Parlement.
Malgré ces considérables divergences idéologiques, des compromis pratiques, qui offrent un socle commun aux diverses propositions de la gauche en la matière, ont toujours été possibles : revalorisation du Parlement, présidence faible, scrutin proportionnel, renforcement des mécanismes de contrôle des élus et de l’initiative populaire, législative ou constitutionnelle, par voie référendaire, droit de pétition etc. La gauche démocratique y voit une manière de substituer des procédures participatives aux institutions représentatives, la gauche républicaine une manière de revitaliser ces dernières, mais les deux, ayant lu Brecht, se félicitent de l’effet de distanciation obtenu. Chacun voit donc les choses à sa manière, mais c’est assez pour se rassembler.
Surtout, c’est assez pour distinguer très clairement la gauche des forces qui rejettent en bloc toute forme d’institutionnalisation de la vie politique, et qui se manifestent ces temps-ci dans les velléités de candidatures de bouffons. C’est en effet une chose que de considérer que la représentation est une fiction parfois utile et parfois pas, c’en est une autre que de nier la nécessité de se doter de règles stables pour organiser la vie collective. Ce socle distingue aussi la gauche de certaines forces sociales-libérales qui, ayant entièrement abdiqué toute critique du présidentialisme, ne sont plus de gauche.
Le dilemme et le piège
Un tel contexte rend évidemment l’injonction présidentialiste de « se rassembler derrière un chef » beaucoup plus difficile à accepter pour la gauche que pour la droite. La difficulté à faire l’unité autour d’une candidature commune ne tient pas, comme on l’entend souvent, aux égos (pas plus pétulants à gauche qu’à droite), ou aux querelles de chapelles. À gauche comme à droite, la politique est aussi question de personnes et de partis, et c’est bien normal : LFI juge qu’un candidat socialiste trahirait les milieux populaires, les socialistes qu’un candidat radical serait incapable de l’emporter, les écologistes se méfient de l’étatisme de LFI… tous ont raison de leur point de vue. Mais tous ont aussi beaucoup à perdre lorsqu’il faut s’unir derrière un allié dont on se méfie.
Les partis de gauche doivent donc choisir entre perdre leur spécificité en s’unissant derrière un concurrent ou s’affaiblir en renforçant la division. Et ceux des partis qui le peuvent rêvent de sortir du dilemme en étant celui derrière qui on s’unit. La gauche est certes parvenue à l’unité en 1981, derrière Mitterrand, mais nombreux sont ceux qui pensent que l’expérience a bien plus changé la gauche que les institutions, et qu’elle marque le début de son déclin, parce que l’unité s’est faite au prix du sacrifice de sa diversité, qui est aussi sa richesse.
Il est vrai que, depuis, LFI propose une « formule » assez nouvelle, celle du « populisme de gauche », selon laquelle le chef est censé être une sorte de « médiateur évanouissant », destiné à cristalliser les forces pour les conduire à la victoire et ensuite à disparaître dans l’initiation d’un nouveau « moment constituant », conduisant à l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont la pierre angulaire est de dépouiller le président de ses pouvoirs. La formule est intéressante et audacieuse, mais elle se heurte à la structure du système (qu’elle ignore superbement). Mais on voit mal comment le « chef de gauche » devenu président ne serait pas immédiatement assiégé par de nombreuses et puissantes forces conservatrices, ni comment, dans ce contexte, il pourrait vouloir sacrifier les rares leviers dont il dispose, à commencer par ses prérogatives. On imagine en revanche fort bien comment il se résoudrait en tout bonne foi à jouer de tous les pouvoirs que lui confère la pratique présidentialiste des institutions. Il ne tarderait donc pas à devenir, plutôt que le « médiateur évanouissant » d’un nouveau processus constituant, un président comme les autres, un monarque élu. Comme à chaque fois qu’un « chef de gauche » a gagné. Non seulement la gauche ne peut s’unir derrière un chef qu’en s’affaiblissant, mais en gagnant, elle se renie, parce que sa victoire signe le renoncement à mettre en œuvre ses projets institutionnels.
La gauche est donc placée devant un dilemme : accepter d’être une « gauche de gouvernement » en faisant le contraire de ce qu’elle dit, ou rester de gauche en se contentant d’exercer une « fonction tribunicienne » qui acte son impuissance à changer la société. Depuis 1983, ce dilemme s’est transformé en un piège dont la gauche ne pourra se sortir sans changer préalablement le système. Il est grand temps d’en prendre acte.
Une proposition pour sortir du piège
Il faut commencer par se rappeler que le système conditionne les comportements et les représentations sans les déterminer entièrement. On peut donc chercher à le subvertir de l’intérieur. La stratégie consiste alors à jouer avec les marges de manœuvre pour en créer de nouvelles plus larges et ainsi de suite. Concrètement, si le régime est présidentialiste, c’est parce que le président nouvellement élu est aussi le chef de la majorité parlementaire. Mais cette confusion n’est elle-même rendue possible que parce que l’ensemble des acteurs, y compris de gauche, ont l’esprit tellement colonisé par les pratiques présidentialistes qu’ils sont devenus incapables de s’imaginer changer le pays autrement qu’en gagnant la présidentielle. Ne pas céder à ce renoncement, qui commande tous les autres, consiste à penser contre le présidentialisme de l’intérieur même de la Ve République.
Une proposition
Plusieurs idées sont possibles. On pourrait par exemple imaginer que la gauche refuse de présenter un candidat à la présidentielle pour se concentrer sur les législatives. Cette solution aurait le mérite d’ouvrir une campagne politique contre le présidentialisme et de redonner de la cohérence aux partis de gauche. Elle aurait le désavantage dirimant de laisser un boulevard à la droite et à l’extrême droite.
Dans une tribune publiée par Libération, nous avons proposé que les forces de gauche s’accordent pour embaucher un acteur, ou une actrice, pour se présenter en leur nom. Rien à voir avec la candidature plus ou moins spontanée d’un bouffon anti-establishment, puisque cet acteur·trice est présenté·e par les partis de gauche et s’engage à faire campagne sur les éléments que chacun de leurs programmes ont en commun. Cette campagne devra d’ailleurs être entièrement dirigée par un comité unitaire créé à cette fin. Ce comité aura pour tâche d’élaborer non pas un véritable programme de gouvernement, mais tout au plus une plate-forme électorale commune, assortie de diverses options. C’est assez pour mener campagne de manière crédible et de nombreuses initiatives récentes montrent que la convergence nécessaire à sa conception n’est pas hors de portée (même sur des sujets aussi difficiles que la croissance ou l’Europe [2]). Chaque parti pourra faire campagne sur ses thèmes de prédilection. Certains choix d’options et arbitrages peuvent être laissés en suspens, dans l’attente que le rapport entre les forces de gauche soit scellé par les législatives. Et c’est alors seulement qu’on pourra s’accorder sur le choix du Premier ministre, l’attribution des ministères et le programme définitif du gouvernement.
Bien sûr, tout ceci suppose non seulement que la gauche gagne les élections législatives mais aussi qu’elle parvienne à former une coalition gouvernementale. C’est le but de notre proposition. Si la droite devait gagner, ce serait à elle de former une coalition ; notre proposition aurait échoué à faire revenir la gauche au pouvoir, mais aurait tout de même le mérite de nous avoir sortis du présidentialisme. Et si la gauche devait gagner sans réussir à s’unir, notre proposition aurait aussi échoué, mais il serait toujours possible d’élargir le spectre de la coalition pour trouver une majorité de gouvernement.
Cette proposition nous paraît idéologiquement, politiquement et juridiquement intéressante.
Idéologiquement, une telle candidature redonnera des couleurs à la gauche, en replaçant la question de la représentation, et de sa fétichisation, au centre du débat politique. L’acteur·trice dira les discours qu’on lui écrira, défendra la plate-forme électorale des partis qui la soutiennent, mais surtout, rappellera une vérité importante : il ou elle n’est qu’un·e acteur·trice, qui n’incarne ni une majorité parlementaire ni le peuple. Élu·e, il ou elle sera mandaté·e par lui, mais ce mandat ne le ou la confondra pas avec ses mandataires. Sa simple existence rappellera que le représentant n’est pas le représenté, ou pour le dire avec Magritte, que « ceci n’est pas une pipe ». Du point de vue de la gauche démocratique, il s’agira de renouer avec une tradition de subversion des institutions, comme quand le Parti communiste (PC) présentait en 1925 aux élections municipales des femmes, non éligibles à l’époque, pour exiger que celles-ci le deviennent.
Du point de vue de la gauche républicaine, il s’agira de revenir à ses sources antimonarchiques, comme lorsque Condorcet, à qui l’on objectait la nécessité de préserver la monarchie, proposait alors de remplacer le Roi par un automate [3]. Cette solution dit en effet, mieux que tout discours, ce que nos concitoyens expriment déjà fort bien par l’abstention ou autour des ronds-points, que la France n’a pas besoin d’un « chef », encore moins d’un « père », et peut-être pas même d’un président ; que la démocratie n’est pas non plus tout à fait soluble dans la représentation, qui n’est qu’une fiction parfois utile, mais pas toujours ; que la politique est aussi une mise en scène, un jeu sérieux auquel on peut jouer sérieusement sans croire aux fictions qui le fondent, en y jouant même d’autant mieux qu’on n’y croit pas.
Politiquement, notre proposition a le mérite de faciliter le rassemblement de la gauche autour d’une candidature unique, sans sacrifier sa diversité, puisque chacun de ses leaders fera campagne sur son propre programme, dans le cadre de la plate-forme électorale commune. Ils feront ainsi vivre le pluralisme de la gauche, sans sacrifier à l’unité nécessaire pour conquérir des majorités d’idées et des rapports de force. De fait, la campagne des présidentielles serait surtout le prologue de la mère des batailles, les législatives.
Elle permet en outre de sortir d’un autre vice du présidentialisme, la personnalisation de la vie politique. Sans doute, journalistes et opposants attaqueront notre acteur·trice sur son engagement. Il est pourtant limpide : il ou elle est là pour faire son métier, réciter son script. Sa vie privée, son opinion personnelle ne touchent pas à la question : il ou elle se contente de mettre en scène, le mieux possible, la plate-forme électorale de la gauche. Il ou elle peut donc même faire la une de Paris-Match si on le lui propose : cela n’apprendra rien aux électeurs des idées qu’il ou elle joue à défendre.
Une telle candidature offre encore une alternative crédible à celle des clowns, qu’il s’agisse de ceux dans la lignée de Berlusconi et Trump ou dans celle de Coluche et Bigard. L’acteur·trice partage certes avec eux certains talents, et éventuellement la notoriété. Mais sa candidature signifie le contraire de l’effondrement du politique dans l’avènement de la souveraineté grotesque telle que décrite par Foucault [4]. Elle ne vise pas à destituer les institutions en les moquant, mais au contraire, et très explicitement, à mettre leurs rouages en lumière en les faisant jouer au service d’un projet de transformation du régime. Il s’agit bien de mettre en scène une fiction, mais cette fiction est éminemment politique et elle n’est pas une farce.
Cette proposition a encore le mérite de se situer assez précisément au point d’intersection des gauches démocratique et républicaine pour espérer qu’elle soit non seulement acceptable, mais hautement désirable pour l’une comme pour l’autre, à la condition bien sûr que l’une et l’autre veuillent bien se souvenir qu’elles sont radicalement opposées au présidentialisme.
Juridiquement, cette proposition est robuste. Il faut certes éviter de signer un contrat en bonne et due forme, ce qui suppose de trouver un acteur ou une actrice qui accepte ce rôle par conviction. Ce qui compte surtout, c’est qu’il ou elle ait le soutien des partis, donc du comité unitaire. Ce soutien rendrait facile la collecte des signatures, comme le financement de la campagne électorale.
Mais que se passera-t-il si l’acteur·trice gagne ? Ne disposera-t-il ou elle pas de pouvoir immenses ? Il faut rappeler avant tout que les pouvoirs d’une autorité quelconque procèdent de la Constitution, et que ceux que la Constitution de 1958 confère au président sont limités. Certes, de Gaulle a joué avec l’idée que le président « procède » du peuple et le Premier ministre du président, comme l’Esprit procède du Père et du Fils pour ne faire qu’un avec lui, mais une relation mystique ne confère par elle-même aucun pouvoir.
Les pouvoirs du président sont limités avant tout par le principe que les actes du président doivent-être contresignés par le Premier ministre, ce qui signifie que le Premier ministre, en refusant, peut entraîner la nullité de ces actes. C’est ce qui explique le développement du régime parlementaire, et aussi pourquoi, en période de cohabitation, le président doit céder l’essentiel de son pouvoir au Premier ministre.
Il est vrai que certains actes sont dispensés du contreseing, mais comme nombre de ces derniers présupposent la participation décisionnelle d’une autre autorité [5], le risque de voir notre acteur·trice user de ces actes pour se lancer dans une aventure personnelle est limité.
De fait, le président n’exerce seul que deux pouvoirs très importants : le droit de dissolution et le fameux article 16. Il en va cependant du droit de dissolution comme de beaucoup d’autres : il ne suffit pas d’en disposer pour être en mesure de s’en servir. Or, le président n’a aucun intérêt à dissoudre s’il n’a pas la possibilité de disposer d’une majorité à l’issue des élections qui suivront. À chaque fois que le président a prononcé la dissolution, c’était parce qu’il avait un espoir de disposer d’une majorité cohérente et disciplinée. Et quand il a mal mesuré ses chances, comme Mac Mahon ou Chirac, l’on a vu ce qu’il lui en a coûté. Notre acteur·trice élu·e, quand bien même il lui prendrait la fantaisie de vouloir réellement exercer le pouvoir politique, aurait les plus grandes difficultés à prendre la tête d’un mouvement à vocation majoritaire, n’ayant aucune autonomie politique propre. Quant à l’article 16, il n’est pas d’un maniement facile, même pour un apprenti dictateur, s’il ne dispose pas de réseaux dans l’administration et dans l’armée. Même Trump, quand il est allé trop loin, s’est heurté au refus d’obéissance de ceux qui jusque-là, semblaient lui être dévoués.
Bref, si les aventures personnelles sont toujours possibles, notre proposition a le mérite de les rendre beaucoup plus difficiles que ne le fait la configuration actuelle. Il y a donc fort à parier que si l’acteur·trice gagne, il ou elle se trouvera dans la même situation que le président du Portugal [1]. Il ou elle n’aura pas présenté de programme de gouvernement, n’aura pas été à la tête d’un parti ni même d’une coalition et n’aura pesé en rien sur les élections législatives, qui verront s’affronter des partis. Les élections législatives se dérouleront selon le mode de scrutin actuel. La gauche, forte de sa victoire, aura de bonnes chances de les gagner, et même si aucun de ses chefs ne peut gagner une élection présidentielle, chacun d’eux pourra peser lourd dans une coalition parlementaire. Cette dernière choisira un Premier ministre qui gouvernera le pays, attribuera les ministères et s’accordera sur un programme définitif de gouvernement.
Objections à notre proposition
Après la publication de notre tribune, nous avons reçu de nombreuses remarques et objections. Répondre à quelques-unes permet de préciser le sens de notre démarche.
La première, et la principale, est évidemment que cette proposition « n’est pas réaliste ». Il est vrai que cette proposition paraît utopique. Ce n’est déjà pas si mal. En effet, une « proposition utopique » n’est pas seulement une proposition concrètement irréalisable, c’est aussi une proposition destinée à dévoiler un impensé idéologique. En l’espèce, nombreux sont ceux qui, même à gauche, trouvent que toute proposition sortant trop du jeu ordinaire du présidentialisme n’est « pas réaliste ». Ils devraient commencer par se demander de quoi leur réticence est le symptôme. Surtout, notre proposition n’est pas seulement utopique. Elle est réaliste parce qu’elle est concrètement réalisable sur le plan institutionnel. Et « concrètement réalisable » ne veut pas seulement dire qu’il suffirait qu’on l’adopte pour la réaliser, mais qu’il est dans l’intérêt de tous les dirigeants des partis de gauche de l’adopter.
Ceux de ces dirigeants qui ne peuvent pas espérer gagner la présidentielle y ont intérêt, parce qu’elle évite que leur poids dans la coalition finisse dilué dans la « majorité présidentielle » godillot après leur échec aux élections. Ainsi, Monsieur Roussel (secrétaire national du PCF ) trouvera aux législatives l’occasion d’affirmer l’existence de son parti, sans risquer une déroute à la présidentielle. De même, s’il fut un temps où les écologistes pouvaient vouloir miser sur une élection nationale du fait de leur faible implantation locale, ils n’ont désormais plus à craindre que l’élection législative soit l’épreuve décisive.
Ceux des dirigeants qui peuvent espérer gagner la présidentielle y ont aussi intérêt, parce que la proposition permet d’éviter que leur candidature fasse courir un risque mortel à toute la gauche, et parce que la victoire de l’acteur·trice leur permet d’espérer raisonnablement prendre la tête de la majorité parlementaire de gauche en gagnant les législatives. Leur leader deviendra alors Premier ministre et gouvernera le pays sans être entravé par le président, désormais dépourvu de pouvoirs réels. Certes, Madame Hidalgo, Monsieur Mélenchon ou Monsieur Jadot devront renoncer à prétendre « incarner la France », mais en démocratie, on peut gouverner sans prétendre incarner quoi que ce soit.
Enfin, tous les dirigeants des partis de gauche y auraient intérêt, parce qu’au lieu de se faire concurrence et de brouiller leur message en s’affaiblissant mutuellement, en mettant leurs forces au service de la victoire de l’acteur·trice, ils placeront donc leur parti en position de peser d’un poids réel dans le futur gouvernement, qui sera proportionnel à leur force, mais augmenté par la dynamique unitaire. Tous peuvent au moins prétendre à un grand ministère. On s’accordera que c’est mieux que de perdre dans la division.
Notre proposition est donc réaliste. Elle le serait du moins, si les leaders de la gauche étaient capables de se décoloniser l’esprit et d’agir conformément à leurs intérêts. Mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas. Non pas parce que ce sont de mauvais dirigeants aveuglés par leur égo et leur chapelle, mais parce que la politique n’est pas tant affaire de calculs rationnels que de passions, d’habitudes et de préjugés. Et c’est vrai que, si notre proposition supposait que les dirigeants de la gauche puissent faire abstraction de leurs passions, habitudes et préjugés, elle serait tout à fait irréaliste, parce que cela n’arrivera jamais.
Ce qui arrivera vraisemblablement, c’est que les dirigeants de la gauche se présenteront à l’élection présidentielle en ordre dispersé, dans l’espoir qu’en « tuant le match », ils imposent aux autres candidats de se rallier à eux, jusqu’à rassembler assez de voix pour être présents au second tour. Mais on sait déjà que jouer à « tuer le match » est une stratégie hasardeuse, dont la gauche elle-même risque de ne pas sortir vivante.
Mais c’est à ce moment précis que notre proposition pourrait redevenir tout à fait « réaliste ». Imaginons que quelque part dans les mois à venir, tous les candidats déclarés constatent qu’ils plafonnent autour de 10 % et que la division a tellement démobilisé les électeurs que la somme de leurs voix est ridicule. Imaginons donc qu’ils se rendent compte qu’ils n’ont pas tué le match, mais que le match les a tués. Peut-être seront-ils alors aveuglés par l’espoir d’un redressement ultime et héroïque, et persévèreront-ils jusqu’au bout dans leur stratégie. Mais peut-être se rendront-ils compte qu’ils sont en train de se suicider politiquement, en sacrifiant durablement la gauche. Peut-être surtout sentiront-ils la pression d’un électorat mobilisé en faveur de l’union. Et peut-être se demanderont-ils alors comment sortir du piège où ils se sont placés eux-mêmes. Peut-être alors se réuniront-ils pour discuter désistements, programme et répartition des places. Ils achopperont alors nécessairement sur la répartition de la seule place qui compte, celle de président. Et là, notre proposition est à leur disposition pour dénouer la situation, en choisissant d’échanger la chronique d’une défaite présidentielle annoncée contre une chance de succès parlementaire. C’est réaliste.
Deuxième objection : « Vous ne vous rendez pas compte, pour se présenter à la présidentielle, il faut être un guerrier de l’espace ». N’ayant jamais vécu de présidentielle de l’intérieur, ceci est vrai : nous ne nous rendons pas compte. Et nous sommes prêts à entendre que le degré de fatigue et de pression, la perversité des coups fourrés, le poids des responsabilités sont tels que non seulement cette élection rend fou, mais qu’elle exige de ceux qui osent s’y lancer qu’ils soient préalablement très névrosés. Ne s’improvise pas leader charismatique qui veut. Il faut savoir déjouer les coups fourrés, fourrer les coups, vivre légèrement les plus lourdes responsabilités, endurer avec entrain la fatigue et la pression, prendre les bonnes décisions, séduire et convaincre. Être un guerrier de l’espace.
L’acteur·trice endurerait fatigue et pression, devrait séduire et convaincre mais n’aurait ni à fourrer les coups, ni à porter les responsabilités, ni même à décider, puisque les chefs aguerris du comité unitaire de campagne s’en chargeraient. Notre proposition n’ôte donc rien à la violence ordinaire de la vie politique, mais cette violence sera endurée non pas tant par l’actrice que par les dirigeants des partis de gauche qui la soutiennent. Voter pour lui ou elle, c’est en effet voter pour eux. Ce qui réduirait d’autant l’intérêt des adversaires de s’attaquer directement à lui ou à elle.
Objection numéro trois : « L’acteur·trice vous trahira parce que le pouvoir corrompt ». En politique, la trahison est toujours possible. Les exemples historiques de corruption par le pouvoir sont légion et personne ne peut savoir ce que le thrill de la victoire est capable de produire dans la psyché de l’acteur·trice. Mais pour vouloir exercer du pouvoir, il faut commencer par en avoir un peu, ou du moins espérer en avoir. Ce ne sera pas le cas : l’acteur·trice n’aura aucune chance de pouvoir contrôler les parlementaires de gauche, qui doivent leur poste à leur parti et non pas à lui ou elle. Il ou elle n’aura aucun moyen de pression sur le Premier ministre. En revanche, la majorité parlementaire de gauche pourrait réduire drastiquement le budget de l’Élysée, une éventualité que notre acteur·trice devra ne pas oublier quand il ou elle se sentira pousser des ailes.
Quatrième objection: « Votre proposition est sexiste ». Il faut l’admettre. Mais nous sommes pris dans une contradiction, qui n’est pas seulement la nôtre. Si nous proposons que notre acteur·trice soit un acteur, nous reconduisons servilement le virilisme avilissant qui domine nos représentations ordinaires : pour être sérieusement un « guerrier de l’espace », il faudrait être un homme. L’élection présidentielle ne serait gagnable que dans un grand déploiement de testostérone, les Français ne peuvent accorder leur confiance qu’à une figure paternelle, etc. Mais si nous proposons que notre acteur soit une actrice, comment éviter le reproche que c’est précisément au moment où il s’agit de transformer le président en potiche impotente qu’on pense aussi à féminiser la fonction ? Il n’y a aucun moyen d’échapper à cette contradiction, qui nous ennuie puissamment. Pour notre part, nous serions enclins à préférer que ce soit une femme, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de voir la gauche nous doter d’une présidente pour la première fois dans l’histoire du pays. Mais comment nier que cette solution verse dans le stéréotype de la plante verte ? En tout état de cause, le comité unitaire de campagne aura là une décision difficile à prendre.
Cinquième et dernière objection : « Vous voulez restaurer le parlementarisme, le retour à la IVe république ». Il y a au moins deux manières de répondre à cette objection : la première, que la gauche républicaine ne désavouera pas, consiste à défendre la IVe république. La seconde, qui devrait avoir la préférence de la gauche démocratique, s’attache à souligner que l’élection de l’acteur·trice est susceptible d’ouvrir une phase de créativité politique nouvelle, et pas seulement de restaurer le parlementarisme.
Cette objection correspond à une conception très répandue chez les juristes, selon laquelle l’histoire constitutionnelle française obéirait à des lois. L’évolution aurait d’abord été cyclique : entre 1789 et 1815, la France serait passée de la monarchie constitutionnelle à la République puis à l’Empire, et cette succession se serait répétée entre 1815 et 1852. Elle serait devenue linéaire à partir de 1870 : chaque régime marque un progrès par rapport au précédent, la IVe cherchant vainement à corriger les défauts de la IIIe. C’est seulement avec la Ve que la France connaîtrait enfin un système stable, efficace et conforme aux idéaux de l’État de droit et de la démocratie. Difficile de ne pas voir dans ce récit une justification ad hoc des institutions présentes plutôt qu’une interprétation crédible de l’histoire.
Mais que reproche-t-on au juste à la IVe République ? Si l’on met à son crédit la reconstruction, l’expansion économique et la protection sociale, on lui impute l’échec de la décolonisation (mais c’est certainement trop attribuer aux institutions politiques de la métropole dans l’affaire). Quant aux vices de ces institutions elles-mêmes, on souligne l’instabilité ministérielle, l’omnipotence du Parlement et sa propension à abandonner au gouvernement une grande partie de son pouvoir, faute de pouvoir l’exercer. Sur ce dernier point, il faut rappeler que c’est là un trait commun à tous les parlements du monde et qu’on le retrouve encore plus accentué sous la Ve République. Quant à l’instabilité ministérielle, elle est incontestable, mais elle était due moins au dispositif constitutionnel qu’à la présence à l’Assemblée nationale de groupes importants, le RPF et le PC, qui n’entraient dans aucune coalition, avec pour conséquence qu’un gouvernement ne pouvait se former et se maintenir qu’avec le soutien de presque tous les autres. Si l’instabilité a disparu après 1958, ce n’est pas tant par le miracle de l’article 49.3 ou par la menace de la dissolution que grâce à la présence quasi constante d’une majorité. Mais c’est au prix de l’abaissement du Parlement et de cette majorité elle-même.
Au final, l’expérience de la IVe République a fait croire, à tort, que le parlementarisme conduisait inéluctablement à l’instabilité. Il y a pourtant bien des États, de l’Allemagne au Portugal, dans lesquels les parlements parviennent à dégager des majorités et même des majorités de coalition qui permettent de gouverner de façon équilibrée.
Si la restauration du parlementarisme ne signe pas forcément le retour de l’instabilité ministérielle, il faut noter qu’elle ne suffit pas non plus à garantir contre la concentration et la personnalisation du pouvoir (voir Netanyahu en Israël), encore qu’elle contribue à compliquer singulièrement l’accaparement monarchique des pouvoirs. Mais il faut surtout noter que cette restauration est un socle à partir duquel le régime peut évoluer dans plusieurs directions, y compris celle de la réalisation des projets les plus audacieux de la gauche.
Aujourd’hui, ces projets se disent surtout dans les termes d’une « VIe République » qui se substituerait à la Constitution de la Ve. Et si l’on peut changer de régime sans changer le texte constitutionnel, on peut aussi vouloir changer le texte pour aller plus loin dans le partage et le contrôle des pouvoirs. La victoire de l’acteur·trice serait donc synonyme de restauration du parlementarisme sans changer la constitution, mais serait aussi susceptible d’ouvrir une phase nouvelle de créativité politique. Tous les projets actuels de VIe République ont en effet pour socle un régime parlementaire monocaméral, auquel sont associés des dispositions de contrôle strict des élus (renouvellement et contrôle régulier des mandats, recall etc.) et de démocratie participative (initiative législative et référendaire populaire, droit de pétition, conventions citoyennes tirées au sort). Parce que tous ces projets visent aussi à neutraliser le pouvoir politique du président, aucun n’est crédible s’il doit être porté par un président fort pour être réalisé. Il peut en revanche être porté par le Premier ministre et sa majorité parlementaire, si le président est notre acteur·trice.
Rien n’interdit en effet à la majorité de gauche au Parlement de vouloir modifier la Constitution. Suite à l’élection de l’acteur·trice, les forces de gauche majoritaires au Parlement doivent pour ce faire obtenir le vote d’un projet de révision dans chaque chambre, puis les trois cinquièmes du Congrès ou bien l’adoption par référendum. Une voie difficile, étant donné la composition du Sénat. Une autre option serait, plutôt que de réviser la Constitution, de convoquer une Assemblée constituante ; il faudrait cependant au préalable réviser la procédure de révision, avec les mêmes difficultés. Une troisième solution consisterait à soumettre le projet directement au référendum (article 11 de la Constitution), sans passer par le Parlement, comme de Gaulle l’a fait en 1962. L’initiative appartiendrait à l’acteur·trice (sur proposition du Premier ministre) ou à défaut à l’initiative de la majorité de chacune des deux chambres. La constitutionnalité de cette démarche est certes très incertaine, et le Conseil constitutionnel pourrait vouloir la bloquer (encore que sa compétence en la matière soit elle aussi très incertaine [6] et qu’il n’ait pas jugé bon d’en faire usage en 1962 et en 1969). S’il devait s’opposer à son adoption, il ouvrirait un conflit politique dont l’issue est indécise.
Ce qui est certain, c’est qu’un tel changement de la Constitution ne pourrait reposer que sur un mouvement populaire puissant, difficile à imaginer quand on regarde le paysage politique actuel. Il est aussi certain que, pour s’engager dans une telle bataille sans craindre de la voir déboucher sur un épisode césariste, il est très préférable que le président soit préalablement dépouillé de l’essentiel de sa capacité politique d’agir. Non seulement notre proposition n’interdit pas les audaces de la gauche démocratique, mais en les délestant du risque autoritaire qu’elles portent, elle répond aux craintes que la gauche républicaine nourrit à leur endroit. Autrement dit, là encore, notre proposition est susceptible de se situer au point d’intersection des deux traditions constitutives de la gauche : celle qui n’a rien contre la IVe et celle qui préfèrerait en inventer une VIe.
Quant à la droite, il est bien difficile de prévoir sa réaction à une victoire de l’acteur·trice. Certains se féliciteront d’un possible retour au parlementarisme. Après tout, il n’y a pas qu’à gauche qu’on pense que l’hyper-concentration du pouvoir conduit à l’impotence et que la vie politique mérite mieux qu’une course de chevaux. D’autres, sans aucun doute, souhaiteront le retour du présidentialisme. Certains se féliciteront d’un changement de constitution favorable au Parlement, à la proportionnelle et aux initiatives populaires, d’autres y verront une catastrophe. L’essentiel ici est précisément que chacun des scénarios rendus possibles par l’adoption de notre proposition sont aussi susceptibles de trouver de forts soutiens à droite. Et qu’en tout état de cause, les institutions fonctionneront.
On l’aura compris, notre proposition est modeste. Elle vise seulement à porter un coup d’arrêt à la pratique présidentialiste, sans avoir au préalable à changer de constitution. Si elle devait fonctionner, nous serions toujours sous la Ve République, mais dans sa version parlementaire. Elle serait en outre susceptible d’ouvrir un nouveau chapitre de notre vie politique. Nous ne prétendons certes pas transformer le système politique par un simple artifice politico-juridique. Mais nous prétendons que cet artifice, ou un autre qui serait meilleur, permettrait à la gauche de sortir du piège mortel dans lequel elle se trouve, permettrait aux institutions existantes de mieux fonctionner et offrirait une possibilité intéressante à ceux qui veulent les changer. Et puis quelle est l’alternative : la défaite ou la fausse victoire sur un coup de chance ? Qu’a-t-on à perdre à essayer ? Pas grand-chose, on est déjà presque mort.
[1] Au Portugal, dont la constitution a été inspirée par la Constitution française, le président de la République y est élu comme en France, au suffrage universel à deux tours, également pour cinq ans. Il a même des pouvoirs plus importants que le président français, par exemple un droit de veto législatif, qui, pour les textes les plus importants, ne peut être surmonté qu’à la majorité des deux tiers, ou le droit de révoquer le Premier ministre dans certaines conditions. Et pourtant, ce président n’exerce qu’une magistrature d’influence, comparable à celle du président de la République italienne ou du président de la IVe République française.
[2] Pour une mise au point récente : Abel Mestre et Sylvia Zappi, « Union de la gauche, la partie d’échecs continue », Le Monde, 10 février 2021. Voir aussi ces initiatives de la société civile : Nabil Wakim et Sylvia Zappi, « De la CGT à Greenpeace, une alliance inédite entre syndicats et mouvements écologistes », Le Monde, 26 mai 2020. Voir encore, autre autres, les initiatives pour une candidature commune à gauche : « 2022, (vraiment) en commun » : l’appel d’élus et activistes de gauche à « une alternative écologique, sociale et démocratique » au néolibéralisme pour la présidentielle sur France Info le 10 octobre 2020 ou encore l’appel à un « Big Bang de la gauche » dans Le Monde, Abel Mestre, 29 juin 2019.
[3] Condorcet, « Lettre d’un jeune mécanicien », Œuvres de Condorcet, tome 12, Didot, 1847, p. 251-253.
[4] Michel Foucault, « Cours du 8 janvier 1975 », in Les anormaux, Cours au collège de France 1974-1975, Paris, EHESS, Gallimard-Seuil, 1999. Pour une reprise de ces thèses au soutien d’une analyse de la présidence Trump, voir l’article de Christian Salmon, « L’hyperréaliste du bouffon — Trump et l’élection de 2020 », AOC, 5 novembre 2020.
[5] Le président de la République peut soumettre au référendum certains projets de loi (mais seulement sur proposition du Premier ministre ou des assemblées) ou un projet de révision constitutionnelle (mais uniquement après un vote par les deux assemblées en termes identiques). Il nomme seul le Premier ministre ou met fin à ses fonctions, mais il est de fait contraint de le choisir dans la majorité parlementaire. Il peut saisir le Conseil constitutionnel d’un traité international ou d’une loi qui vient d’être adoptée, mais ce sera la juridiction qui décidera de leur validité.
[6] Le Conseil constitutionnel se juge compétent pour contrôler le décret de convocation des électeurs, au fondement de l’article 60 de la Constitution qui lui confie « la charge de veiller au bon déroulement des opérations de référendum ». Mais la nature et la portée de ce contrôle restent très débattues pour ce qui concerne un référendum constituant – voir Jean-Marie Garrigou-Lagrange, « Les contrôles du Conseil constitutionnel sur les décrets de convocation des électeurs au référendum », Les Petites affiches, 2002, n° s.n., p. 4-12.
Juriste, Professeur émérite de droit public, Université Paris-Nanterre
Juriste, Professeur de droit public, École de droit de Sciences Po